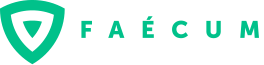La pièce de théâtre Christine, la reine-garçon a ravi les spectateur·rice·s à la fin de la semaine dernière au Centre d’essai de l’UdeM. Elle est la deuxième production de la saison 2024-2025 de la troupe Théâtre Université de Montréal (TUM), présentée dans le cadre du Fest’hiver.
Cette pièce du dramaturge québécois Michel Marc Bouchard prend place en 1649 au château d’Uppsala, en Suède, et relate l’histoire de la reine Christine, alors âgée de vingt-six ans, qui invite le philosophe René Descartes à venir l’éduquer sur la nature et le mécanisme des passions. La reine doit assurer sa descendance et choisir un mari, mais elle a soif de liberté et s’amourache de l’une de ses dames de compagnie, défiant ainsi le sens du devoir qui régit sa fonction.
La place de la femme à travers les âges
Outre le déchirement entre raison et passion qui tenaille Christine, la pièce aborde des enjeux féministes tels que l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que les rôles genrés qui leur sont attribués.
La scène dans laquelle la reine est furieuse contre son cousin Karl Gustav, après que ce dernier a tenté de la violer lors d’une promenade à cheval, est un exemple flagrant de ces enjeux. Celui-ci, au lieu de s’excuser de l’avoir plaquée au sol avec animosité, réplique simplement que le vent l’a poussé vers elle, ce qui met en évidence la place accordée à la notion de consentement et à la minimisation de la violence sexuelle, à l’époque comme aujourd’hui.

En ce qui concerne le rôle attendu des femmes de son époque, Christine a été élevée comme un prince, une « reine-garçon », et refuse de devenir une épouse soumise. Elle défend son célibat avec véhémence et verbalise ouvertement sa colère à l’idée de devoir se conformer. À propos de l’enjeu ancestral, mais ô combien actuel d’avoir des enfants, elle déclare ne pas vouloir être « engrossée comme une truie ».
Des enjeux persistants à l’ère post #moiaussi
Christine, la reine-garçon, bien que jouée pour la première fois en 2012, pourrait tout à fait s’inscrire dans la lignée du mouvement #moiaussi, tant la reine dénonce avec fougue le comportement machiste et déplacé des hommes qui la courtisent.
Mouvement #moiaussi (#metoo)
La militante pour les droits civiques Tarana Burke a fondé en 2006 le mouvement #MeToo pour dénoncer les violences sexuelles.
Celui-ci a pris véritablement son envol en octobre 2017, dans la foulée de l’affaire Harvey Weinstein, lorsque l’actrice américaine Alyssa Milano a lancé, sur Twitter, un appel aux survivantes de harcèlement ou d’agressions sexuelles, les invitant à publier un message disant « moi aussi » (#MeToo) afin de sensibiliser le public à l’ampleur du problème.
Au cours des années suivantes, #MeToo (et ses équivalents #MoiAussi au Québec et #BalanceTonPorc en France) a galvanisé un mouvement militant qui a eu des effets tant en ligne que dans le monde réel.
Source : Le Devoir
Par des dialogues crus et résolument modernes, la reine se révolte contre ses prétendants qui la somment brutalement d’« assume[r][s]on devoir et [d’]ouvr[ir][s]es jambes ».
Près d’une décennie après les débuts du mouvement #moiaussi, le Québec connaît un retour d’une pensée antiféministe et d’un rôle traditionnel des femmes dans la société, mis en lumière dans le documentaire Alphas, en ligne sur Télé-Québec, qui a suscité l’émoi après sa diffusion en novembre dernier.
Les propos sexistes des hommes de la pièce, comme ceux du cousin Karl Gustav ou du comte Johan, résonnent douloureusement avec ceux des masculinistes d’aujourd’hui.
Par exemple, lorsque Christine s’amourache de sa dame de compagnie, ses soupirants se sentent insultés de ne pas avoir la préférence d’une femme et déclarent que « les femmes ne peuvent pas se passer du plaisir des hommes ».

Des dynamiques de pouvoir actuelles
Pour la metteuse en scène Camille Messier, qui a pour sujet de prédilection la dramaturgie québécoise féministe, Christine, la reine-garçon s’inscrit parfaitement dans son champ d’intérêt.
« Choisir de jouer cette pièce était orienté vers ce que j’avais envie de faire, mais je me suis aussi demandé ce qu’il serait pertinent de monter avec des jeunes de l’UdeM, confie-t-elle. Avec tout ce qu’il se passe en ce moment, avec les manifestations antitrans, par exemple, j’avais envie de défendre ces enjeux-là. »
Mme Messier a déjà eu le plaisir de mettre en scène de fortes dynamiques de pouvoir en 2022 dans la pièce Hurlevents de la dramaturge québécoise Fanny Britt, toujours avec la troupe TUM. Cette pièce l’avait également « profondément bouleversée par l’actualité de ses thématiques ».

Coups de cœur Quartier Libre
Quartier Libre a particulièrement aimé le jeu d’acteur de trois comédien·ne·s.
D’abord celui d’Alex Chartier, qui interprète le comte Johan. Celui-ci, avec toute « l’altitude de [s]a vanité », essaie tant bien que mal de séduire la reine et d’éliminer ses ennemis. L’étudiant en urbanisme utilise tout son corps pour transmettre la soif de sexe autant que de sang qui l’habite.

Par son jeu, l’étudiant en anthropologie Jules St-Jean, qui joue le rôle de Karl Gustav, réussit à dépeindre ce personnage instable et immature grâce à des expressions faciales convaincantes. Il ouvre ainsi la pièce dans une scène au cours de laquelle il presse sa cousine, la reine Christine, de l’épouser. Son « épouse-moi ! » incarne un cri de désespoir qui illustre bien le côté obsessif, voire fanatique, de ce cousin insistant.
Enfin, Anouk Pabiou, qui donne vie à René Descartes, apporte une note comique à ce philosophe qui a réponse à tout, mais sait combien la réalité humaine est loin d’être théorique. Jouant de ses grands yeux auxquels aucun détail n’échappe, l’étudiante en philosophie (quel hasard !) incarne à merveille son personnage, qui pose un regard amusé et amusant sur les êtres qui l’entourent.