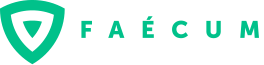Dans le cadre de l’objectif qu’elle s’est fixé d’atteindre la carboneutralité d’ici 2040, l’UdeM multiplie les mesures pour amoindrir son impact environnemental. Malgré l’observation de progrès notables, des doutes persistent quant à la réelle efficacité du plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’établissement.
Le 26 novembre dernier, l’UdeM a annoncé la réfection de la centrale thermique du campus de la montagne. Si l’information peut paraître anodine, elle a, en vérité, une incidence sur l’atteinte des objectifs de carboneutralité de l’Université. Le remplacement de deux chaudières permet, en effet, de diminuer la part de gaz naturel dans le bouquet énergétique de l’établissement au profit de l’électricité, ce qui va lui permettre de réduire considérablement ses émissions de GES.
Réduction des émissions de portée un et deux
« 49 % de toutes les émissions produites par la consommation d’énergie de l’Université sont liées à l’utilisation des chaudières de la centrale thermique qui fonctionnent au gaz naturel », explique le conseiller à la lutte aux changements climatiques de l’Unité du développement durable (UDD), Thierry Gras Chouteau, à UdeMNouvelles.
Grâce à ce changement, l’Université pourra réduire jusqu’à 18 % de ses émissions totales de GES de portée un et deux. Elle n’aura donc plus que 2 % à aller chercher pour atteindre son objectif de réduction de 20 % d’ici 2025.
LES TROIS PORTÉES D’ÉMISSIONS CARBONE
Le protocole international Greenhouse Gas Protocol classe les émissions de GES d’un organisme ou d’une activité en trois portées en fonction de leur provenance :
Portée un : émissions directement liées aux opérations, comme la combustion pour le chauffage, les fuites de gaz réfrigérant, les émissions des véhicules ;
Portée deux : émissions indirectes liées à l’achat d’électricité, de chaleur ou de vapeur ;
Portée trois : émissions indirectes, comme les déplacements du personnel et des étudiant·e·s.
En parallèle, l’UdeM compte notamment sur la remise au point des systèmes mécaniques des bâtiments, aussi appelée «recommissioning». Cette démarche vise à utiliser plus efficacement les équipements actuels pour consommer moins d’énergie.
Toujours dans l’objectif de diminuer sa consommation énergétique, l’Université adhère au programme de gestion de la demande de puissance (GDP) d’Hydro-Québec. À la manière du programme Hilo, destiné aux particuliers, celui-ci consiste à réduire la consommation d’électricité lors des pointes hivernales. « Il s’agit davantage d’une mesure économique qu’écologique, nuance toutefois le conseiller stratégique dans le domaine de l’énergie Alex Bigouret. La consommation évitée lors des pointes hivernales grâce à la GDP demeure anecdotique à l’échelle d’une année, et il ne s’agit pas d’une mesure structurelle et définitive de réduction de la consommation. »
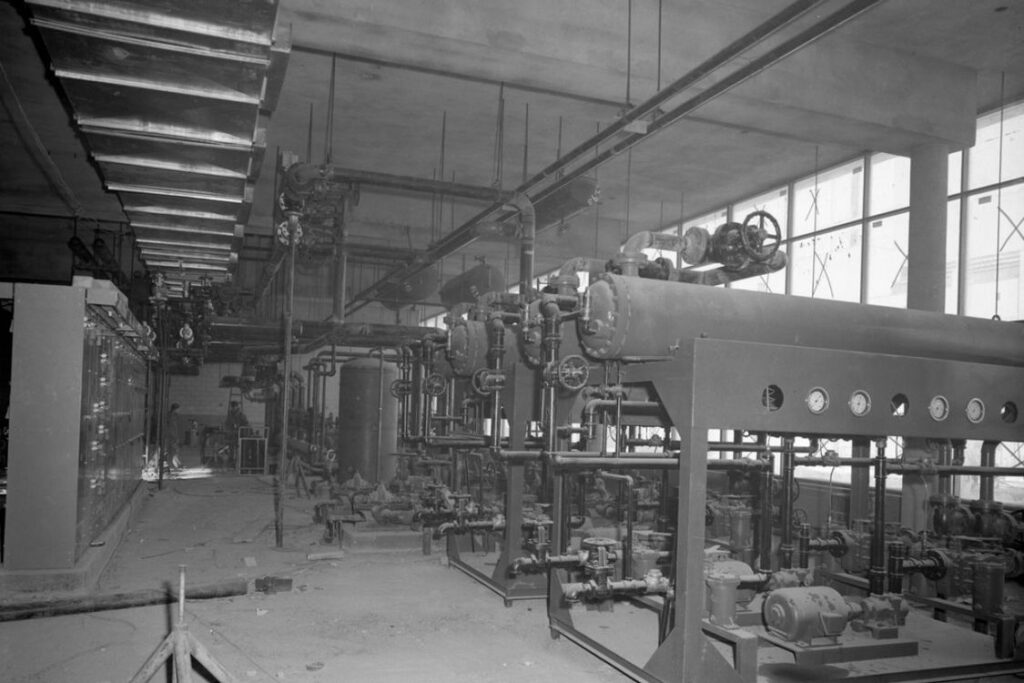
L’entreprise de distribution de gaz naturel Énergir lui a également octroyé un financement de 650 000 $ pour la mise en place de mesures similaires. Ces exemples illustrent bien la contribution clé de la Direction des immeubles à la réduction des émissions de GES de l’Université. Il y a environ deux ans, l’arrivée d’une nouvelle équipe à la Division des services techniques, chapeautée par Jonathan Roy,
a marqué un tournant. Elle est notamment à l’origine d’un comité énergie qui œuvre à l’élaboration d’une feuille de route plus opérationnelle du plan de réduction des GES de l’UdeM.
Les émissions de portée un et deux, sur lesquelles la Direction des immeubles est capable d’agir, ne représentent toutefois respectivement que 36,4 % et 0,27 % des émissions totales de l’UdeM. Celles de portée trois, que l’Université n’inclut pas dans son objectif de carboneutralité à l’horizon 2040, représentent pour leur part 63,3 % des émissions.
Et les émissions de portée trois dans tout ça ?
« Il n’y a pas encore de méthodologie claire qui permette de quantifier les émissions de portée trois, précise le directeur de l’Unité du développement durable, Ronald Jean-Gilles. Il existe aussi des débats idéologiques qui disent que les émissions de portée trois de quelqu’un sont également celles de portée un de quelqu’un d’autre. »
Au printemps 2024, les huit établissements universitaires de la métropole ont donc annoncé développer une méthodologie commune pour le calcul des émissions de portée trois. Pour ce faire, ils doivent maintenant récolter des données les concernant.
Ce travail est l’un des objectifs du «Fonds carbone », dont l’UdeM a annoncé le lancement le 1er octobre dernier. Celui-ci consiste en une enveloppe budgétaire donnant la possibilité aux unités administratives de l’Université, si elles le souhaitent, de procéder à l’achat de crédits compensatoires dans le cadre des déplacements professionnels des membres du personnel.
En plus de l’achat de crédits compensatoires, la mise en place du Fonds carbone permettra à l’Université de collecter des données sur les déplacements professionnels de ses employé·e·s et de sensibiliser sa communauté à leurs effets. « On voit aussi [ce Fonds] comme une mesure de réduction, car on veut sensibiliser les gens aux émissions générées par leurs déplacements », ajoute M. Jean-Gilles.
LES CRÉDITS CARBONE COMPENSATOIRES :
L’achat de crédits carbone auprès d’organismes de compensation permet de financer des projets qui réduisent ou retirent des GES de l’atmosphère, comme des plantations d’arbres, qui vont séquestrer du carbone, ou des programmes éducatifs, qui vont enseigner comment atténuer son impact environnemental.
Un crédit carbone correspond à une tonne de GES et son tarif varie en fonction des organismes.
« On a déjà identifié sept organismes de compensation qui correspondent à nos attentes, souligne M. Jean-Gilles. On va vérifier une nouvelle fois leurs processus avant de valider avec lequel on fera affaire. »
Le conseiller stratégique dans le domaine de l’énergie Alex Bigouret pointe toutefois plusieurs bémols dans la mise en place du Fonds carbone. « Dans le domaine de la compensation carbone, il faut parvenir à équilibrer la contrainte et les pénalités avec le volontariat, détaille-t-il. Avec le Fonds carbone, les déplacements ne sont pas remis en question, en plus du fait que la compensation ne soit que volontaire. » L’expert remarque également que la contribution maximale s’élève à 100 dollars canadiens. « Pour un vol Montréal-Singapour, ça ne pèse pas beaucoup», soulève-t-il.
Par ailleurs, seul·e·s les employé·e·s des unités administratives ont accès au programme. Les unités d’enseignement, elles, n’ont pas encore accès au Fonds carbone et ne peuvent donc pas compenser les déplacements des chercheur·euse·s qui se rendent, par exemple, à des colloques à l’étranger.
« J’aimerais connaître leur part dans les déplacements professionnels de l’UdeM, par rapport aux professeurs », poursuit M. Bigouret. La porte-parole de l’UdeM, Geneviève O’Meara, précise que le Fonds carbone est encore en phase de test, avant d’être plus largement déployé.
L’éléphant dans la pièce
Parmi les émissions de portée trois de l’UdeM, celles que génèrent les placements financiers de l’Université ont provoqué de vives controverses pendant la session d’hiver 2022.
Le Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université de Montréal (SGPUM), la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM) ainsi que plusieurs regroupements étudiants s’étaient en effet indignés des placements directs et indirects liés aux secteurs des énergies fossiles que l’établissement possédait, par l’entremise de son régime de retraite, le RRUM, et de son fonds de dotation. Plusieurs étudiant·e·s membres du regroupement écologiste L’Écothèque avaient alors occupé le pavillon Roger-Gaudry pendant six jours. Deux des manifestant·e·s avaient même entamé une grève de la faim.

« Conformément à la réflexion amorcée par la direction à l’automne 2021, je déposerai devant les instances exécutives de l’Université, d’ici le 1er juin 2022, un ou des scénarios de désinvestissement total avant le 31 décembre 2025, des actions cotées en bourse de l’industrie des énergies fossiles, détenues directement ou indirectement par l’Université dans son fonds de dotation », avait annoncé le recteur de l’UdeM,
Daniel Jutras, dans une lettre adressée aux occupant·e·s, en précisant que cette question faisait déjà l’objet d’une réflexion avancée avant la mobilisation.
« Les investissements dans le domaine des énergies fossiles représentaient environ 4 % de la valeur du portefeuille de l’UdeM, nuance toutefois M. Bigouret. Avec le désinvestissement, on reste dans quelque chose de plutôt symbolique. » L’Université n’a d’ailleurs jamais précisé l’intensité carbone de ces placements, c’est-à-dire la quantité de GES que ces derniers génèrent.
En ce qui concerne le RRUM, M. Jutras a expliqué dans sa lettre aux occupant·e·s que faire pression « n’ [était] pas possible, compte tenu de [s]on obligation légale d’assurer l’indépendance complète du comité de retraite quant à sa gestion fiduciaire du RRUM ». En effet, bien que plusieurs membres de
l’UdeM siègent à son comité, ce dernier fonctionne indépendamment de l’Université.
Presque deux ans plus tard
Selon le rapport 2023-2024 du fonds de dotation, 1,8 % des actifs de l’UdeM provenaient toujours des énergies fossiles au 31 décembre 2023, contre 4,4 % au 31 décembre 2022. En un an, l’Université a donc baissé ses investissements de 54 % dans ce domaine. Le rapport témoigne aussi d’une réduction de 55 % de l’Intensité carbone moyenne pondérée (ICMP) par rapport à 2020, d’une baisse de 54 % des émissions de carbone ainsi que d’une réduction de 58 % de son empreinte carbone. (Voir encadré «Les différents indicateurs carbone»)
LES DIFFÉRENTS INDICATEURS CARBONE
L’émission carbone mesure les tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone (tCO2e ou t éq. CO2) attribuables à un portefeuille.
L’empreinte carbone mesure les tonnes d’émissions totales d’un portefeuille normalisées par la valeur marchande d’un portefeuille.
L’intensité carbone moyenne pondérée (ICMP) exprime l’exposition du portefeuille aux entreprises intensives en carbone (à fortes émissions carbone), en fonction de la pondération des entreprises dans le portefeuille.
Source : Rapport sur l’implantation de la Politique en matière d’investissement responsable et des principes pour l’investissement responsable du fonds de dotation de l’UdeM (2020).
Quant au RRUM, évalué à 4,83 milliards de dollars au 31 décembre 2023, le rapport 2023 indique une réduction de 40 % de l’ICMP du portefeuille total d’actions par rapport à 2019, une baisse de 39 % des émissions de carbone ainsi qu’une réduction de 29 % de son empreinte carbone. L’UdeM a donc atteint son objectif de réduire de 30 % l’ICMP de ces deux portefeuilles avant 2030.
« Cette mesure [l’empreinte carbone] n’est pas très fine, malheureusement, estime le professeur au Département d’anthropologie de l’UdeM Adrian Burke. Elle donne l’impression que l’on a amélioré notre empreinte carbone et notre performance en termes d’émission de CO2, mais, en réalité, c’est parce que l’inflation en a affecté la valeur. »
Ce constat est le même pour l’ICMP, qui, pour baisser, exige des pollueurs qu’ils réduisent leurs émissions de GES ou deviennent plus rentables.
De plus, certains investissements restent indirectement liés aux secteurs des énergies fossiles, à l’instar du fonds de dotation, qui présente des actions de la Banque Royale dans son tableau des dix principaux titres publics. « La Banque Royale est la cinquième banque au monde et la première au Canada pour l’investissement dans les pipelines, gazoducs, etc., explique M. Burke. C’est elle qui finance tout. C’est un triste constat. »
Le professeur, qui siège au comité du RRUM, s’interroge aussi sur les placements de ce portefeuille, qui se trouvent en dehors de ce top 10. « Il y a dix ans, on aurait vu dans le top 10 des compagnies d’énergies fossiles ; aujourd’hui, non, indique-t-il. Mais ça ne veut pas dire que nous n’avons pas des dizaines, voire des centaines de millions de dollars investis dans des compagnies de pétrole, de gaz, etc. »
Vers la carboneutralité ?
« Pour le moment, l’Université se concentre sur les mesures les plus faciles à mettre en œuvre, affirme M. Bigouret. Comment va-t-elle s’y prendre pour celles qui sont plus compliquées à mettre en place ? »
L’expert signale que le plan de désinvestissement ne quantifie pas une grande partie des mesures annoncées et ne donne pas de précisions sur leur mise en place opérationnelle, par exemple, pour le covoiturage. « Est-ce que l’Université va inciter financièrement ses employés à le faire ? »,
se demande-t-il.
LE PLAN DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES DE L’UDEM
L’UdeM souhaite atteindre la carboneutralité pour ses portées un et deux d’ici la fin de l’année 2024, ce qui représente respectivement l’équivalent de 30 811 tonnes et 229 tonnes de CO2. Elle souhaite réduire les émissions de gaz naturel, de mazout et de diesel de son parc immobilier (28512 t éq. CO2), de sa flotte de véhicules institutionnels ou encore de ses technologies de l’information.
En ce qui concerne les émissions de portée trois, qui représentent l’équivalent de 53597 tonnes de CO2, l’UdeM s’est engagée à réduire l’empreinte carbone de son portefeuille d’actions pour son fonds de dotation de 20 % d’ici 2025 et de 30 % d’ici 2030 par rapport à 2020. Elle a aussi décidé de rendre son fonds de dotation exempt d’énergies fossiles d’ici 2025. Par ailleurs, le Comité de retraite s’est engagé à atteindre les mêmes cibles pour le Fonds de retraite (RRUM), mais cette fois-ci par rapport à l’année 2019.
L’UdeM souhaite aussi réduire ses émissions liées aux matières résiduelles, à sa consommation d’eau, à la mobilité de sa communauté, mais aussi favoriser les fournisseurs locaux et écoresponsables ou encore mettre en place des puits de carbone grâce à la plantation d’arbres.
Source: Rapport du plan de réduction des émissions de GES de l’UdeM (2023).