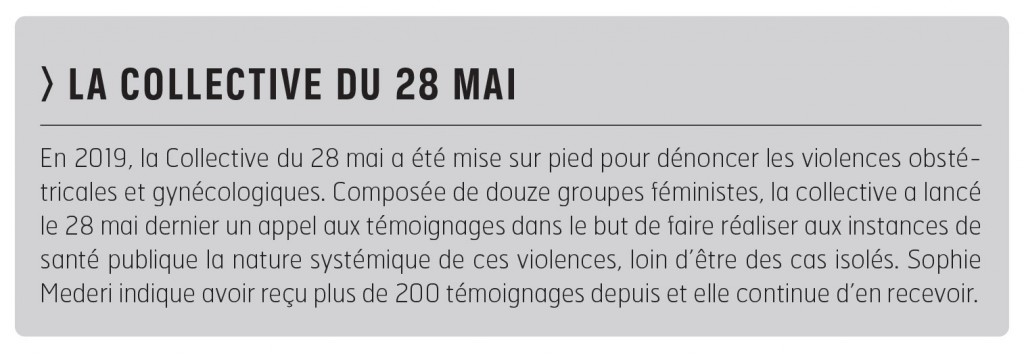La responsable de projet du Regroupement Naissance Renaissance (RNR), Sophie Mederi, définit les violences obstétricales et gynécologiques (VOG) comme « tout comportement, acte, omission ou abstention commis par le personnel de santé qui n’est pas justifié médicalement ou qui est effectué sans le consentement libre et éclairé de la personne qui requiert les soins. »
L’accompagnante à la naissance Marie-Ève* a vécu deux avortements espacés de 18 ans. Pour chacune de ces expériences, le manque d’empathie du personnel soignant l’a affectée. Elle a subi le premier à l’âge de 18 ans. « L’anesthésiste n’arrivait pas à me piquer, j’étais trop nerveuse, il n’y avait aucun support émotif à ce moment-là, explique-t-elle. Il a décidé de me faire une anesthésie générale alors que je n’ai jamais consentie, parce qu’il n’arrivait pas à me piquer et qu’il s’impatientait. » À son réveil, les propos d’une infirmière sur la raison de sa présence à l’hôpital la plongent dans une culpabilité qu’elle mettra du temps à relativiser.
Au moment de son second avortement, alors qu’elle refuse une intraveineuse, Marie-Eve se fait dire par une infirmière que le médecin refuse de pratiquer l’intervention si elle maintient son refus. « Ça m’a tellement découragée, confie-t-elle. Me faire dire : « Plie-toi ou tu n’auras pas ce que tu veux », ça m’a vraiment dégouté. »
Une vision sexiste du corps de la femme
Selon Marie-Eve, la souffrance des femmes est banalisée. « Elles vont se présenter avec des douleurs abdominales et on ne va pas les traiter tout de suite, parce qu’elles sont « hystériques » ou « faibles » », dénonce-t-elle.
Mme Mederi estime que les champs de l’obstétrique et de la gynécologie (OBGYN) ont toujours été teintés de sexisme. « Notre société est encore traversée par du sexisme, et les médecins ne font pas exception, constate-t-elle, précisant qu’il peut s’agir d’hommes comme de femmes. On croit peu les femmes. Il y a encore cette mentalité de dire que la femme est trop émotionnelle, qu’elle ne comprend pas, qu’elle se plaint pour rien, donc on va décider à sa place. »
Souffrant d’endométriose depuis le début de ses menstruations, l’enseignante de 38 ans Amélie*considère avoir été victime de ces violences. Elle souligne qu’il aura fallu 24 ans avant qu’elle se fasse correctement diagnostiquer. Elle atteste que ces violences psychologiques ont affecté sa vie, jusqu’à développer des pensées suicidaires. « À un moment, je me suis dit que ça devait vraiment être dans ma tête, que je devais être folle, avoue-t-elle. Tout le monde doit avoir la même douleur que moi et je n’arrive pas à passer au travers. »
Elle déplore le traitement accordé par le corps médical, invalidant d’après elle son droit de se plaindre. « Combien de fois me suis-je fait dire, parce que je criais de douleur : « Mais madame est-ce que vous êtes en dépression ? » Je ne suis pas en dépression, bordel, j’ai mal ! », illustre-t-elle.
Le consentement implicite et la notion d’urgence
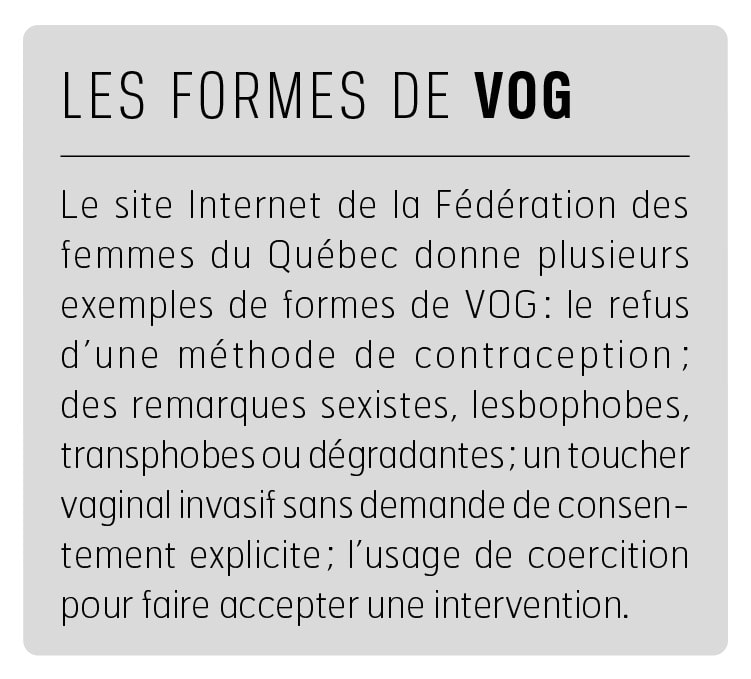 « La notion d’urgence est fréquemment invoquée dans le milieu [obstétrical], parce que, dans la loi, c’est là où on peut passer outre le consentement d’une personne, précise la diplômée d’une maîtrise en sociologie à l’UQAM Mathilde Grenier. On considère qu’une personne qui est en train d’accoucher est complètement vulnérable et pas tout à fait apte à consentir. » La diplômée s’interroge toutefois sur la frontière entre le consentement et l’abus qu’implique cette notion d’urgence.
« La notion d’urgence est fréquemment invoquée dans le milieu [obstétrical], parce que, dans la loi, c’est là où on peut passer outre le consentement d’une personne, précise la diplômée d’une maîtrise en sociologie à l’UQAM Mathilde Grenier. On considère qu’une personne qui est en train d’accoucher est complètement vulnérable et pas tout à fait apte à consentir. » La diplômée s’interroge toutefois sur la frontière entre le consentement et l’abus qu’implique cette notion d’urgence.
« On est très au courant que, quand on va faire un toucher vaginal, c’est intrusif et ça demande un consentement explicite », rappelle Mme Mederi. D’après elle, certains médecins s’autorisent à ne pas le demander pour différentes raisons. « À cause de la formation qu’on a reçue, du milieu dans lequel on baigne, ce genre de choses sont normalisées », regrette-t-elle.
Mathilde, qui a rédigé en 2019 son mémoire sur le consentement dans la formation médicale en OBGYN, abonde dans ce sens. Selon elle, l’apprentissage en médecine se fait par « osmose » : les étudiants à l’externat et les résidents observent les gestes du médecin qui les supervisent. C’est ainsi que le savoir-faire et le savoir-être du mentor sont transmis. « Si on ne fait qu’observer et répéter les mêmes gestes vus chez les patrons et que ces gestes ne sont pas adéquats, alors c’est sûr qu’il y a une reproduction sociale de pratiques inadéquates », poursuit Mathilde.
Selon Le consentement : Guide à l’intention des médecins du Canada, document fourni par l’Association canadienne de protection médicale, les médecins devraient être raisonnablement confiants que le comportement du patient implique une autorisation. « Pour éviter cependant tout malentendu, il est peut-être plus prudent de faire part au patient de toute intention d’examiner les seins, les organes génitaux ou le rectum », peut-on lire.
La sensibilisation des étudiants
« Je trouve qu’on n’est pas vraiment mis au courant au cours de la formation », déclare l’étudiante en médecine à l’Université McGill Geneviève Peel1, au sujet des VOG. Elle se rappelle avoir posé des questions à ce sujet à l’un de ses professeurs, également gynécologue. « Il m’a dit que c’est un phénomène qui existe, mais que ce n’est pas vraiment de l’abus », se remémore-t-elle.
Pour l’étudiant en médecine à l’externat de l’UdeM Yong Mu Ouyang, l’attitude parfois paternaliste d’obstétriciens envers les patientes est un problème appartenant majoritairement à une génération de médecins maintenant proche de la retraite. Selon lui, le parcours d’études permet de correctement sensibiliser les étudiants à ce sujet. « À la faculté, on nous a parlé de la violence obstétricale lors des divers cours sur l’éthique, certifie-t-il. Le « consentement libre et éclairé » est un concept enseigné et clarifié à chaque étape de notre formation. »
Geneviève juge insuffisantes les informations transmises sur les VOG au cours de sa formation. « Je ne trouve pas ça normal qu’on n’en parle pas, s’étonne-t-elle. Je pense même que ça serait notre devoir, en tant que futur médecin, de connaître ce phénomène et de le reconnaître quand on va le voir dans les hôpitaux. »
À l’inverse, Yong Mu Ouyang trouve le travail de la Faculté de médecine de l’UdeM adapté. « La faculté fait plus que ce qu’il faut pour sensibiliser et outiller les étudiants dès leur première journée dans le programme, pour ne pas reproduire les mêmes dynamiques problématiques telles que celles décriées dans les médias », affirme-t-il.
En complétant son stage en OBGYN, l’étudiant a suivi sur le campus un atelier où est simulé un examen gynécologique. « L’apprentissage se fait à travers des entrevues que nous devons conduire avec des actrices jouant des patientes dans des situations plausibles et elles se concluent toujours avec un débriefing par les actrices, les étudiants impliqués et le ou la gynécologue animant l’atelier », détaille-t-il.
Des recommandations
Pour Mme Mederi, donner une plateforme aux étudiants témoins d’actes non éthiques est nécessaire. « Quand les étudiants en médecine observent des pratiques de leur formateur qui les choquent, ils n’ont pas d’endroit pour en discuter, soulève-t-elle. Ils voient des choses horribles qu’ils ne peuvent pas rapporter. »
Geneviève encourage ses pairs à garder un esprit critique à ce sujet, lorsqu’ils sont témoins de pratiques plus ou moins éthiques, malgré la hiérarchie en place. « En tant qu’étudiant, il faudrait qu’on le remette en question, insiste-t-elle. Mais quand tu es sur le terrain, ce n’est pas facile de questionner ce que ton patron fait. »
L’étudiante œuvre en tant que coprésidente du regroupement étudiant McGill Feminism in Medicine, qui a pour objectif de sensibiliser ses collègues. « On organise des ateliers avec le Regroupement Naissance-Renaissance pour parler de ce sujet-là. » Elle précise que ces initiatives restent purement étudiantes et ne sont pas endossées ni freinées par la Faculté de médecine.
* Les intervenantes ont souhaité conserver leur anonymat.
1. Les propos reflètent uniquement l’opinion de Geneviève Peel ; ils ne reflètent pas celui de l’Université McGill, de la McGill Students’Society ou du regroupement étudiant McGill Feminism in Medicine.