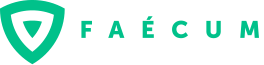Le huitième long-métrage du cinéaste François Delisle, Le temps, est sorti en salles le 18 avril dernier. Malgré une grande inventivité formelle, ce récit écologiste manque de profondeur politique.
Au cœur de cette fresque environnementale, les vies de quatre personnages s’entremêlent à travers les époques. En 2021, Marie, une jeune mère, intègre un groupe militant pour contrer son écoanxiété. En 2042, Terrence voyage à l’arrière d’une camionnette avec d’autres réfugié·e·s climatiques, cherchant asile au Canada. En 2088, l’agent d’État McKenzie transgresse les règles de sa profession. Enfin, en 2174, Kira quitte l’armée pour rejoindre les rangs d’une communauté humaniste, au cœur de la taïga.*

Choix esthétiques marquants
Le temps présente une succession d’images fixes, dans le style du roman-photo. Ce parti pris, en écho à la carrière expérimentale du cinéaste, propose une expérience de visionnage particulièrement intéressante. Si cette configuration peut d’abord déstabiliser, les voix hors champ des personnages portent le récit, le rendant agréable à suivre. Les plans figés invitent le public à la réflexion, à l’instar des pensées de Marie : « si on veut voir ce qui va arriver dans le futur, on devrait s’arrêter ».
Malgré le rythme saccadé, les sons d’ambiance offrent en effet une immersion complète dans l’environnement des protagonistes. Ce riche travail sonore aurait pu se suffire à lui-même, car les quelques passages musicaux donnent un ton dramatique un peu exagéré.
À l’écran, les décors font ressentir avec brio les conséquences du dérèglement climatique. Dans la ville de McKenzie, les bâtiments réduisent le champ de vision des spectateur·rice·s à un monde gris et oppressant. Quant à la taïga dans laquelle (sur)vit Kira, il n’en reste qu’un arbre vert au milieu d’étendues rocheuses et désertiques à perte de vue. Lors d’une mission, dont l’objectif est le massacre d’innocent·e·s qui se trouvent dans un campement en Alaska, l’imagerie militaire dans les tons vert et noir crée une atmosphère glaçante. En contraste avec ces portraits dystopiques, le discours de Marie prend presque une valeur prophétique.
Les trajectoires narratives des protagonistes donnent à ces dernier·ère·s une certaine profondeur, permettant au public de s’attacher à ces personnages. Les destins de Kira et de McKenzie demeurent les plus marquants, en raison de la fuite de leurs systèmes très encadrés et de la remise en question de leurs valeurs.

Un discours écologiste, mais privilégié
Un certain paradoxe réside néanmoins dans Le temps. Par l’entremise du personnage de Marie, l’intrigue témoigne de différentes perspectives occidentales face à l’urgence climatique. Quand la protagoniste aborde le sujet avec son époux, ce dernier n’exprime que de l’indifférence, considérant que ces préoccupations sont loin de lui. Au cours du film, Marie prend peu à peu conscience du privilège que représente son inquiétude pour l’avenir, quand d’autres sont occupé·e·s à survivre.
Pourtant, dans le film, les catastrophes naturelles, les conflits et la violence ne se manifestent que dans des contextes postapocalyptiques, éloignant ainsi ces enjeux pourtant bien ancrés dans la réalité actuelle. Les populations qui subissent les plus lourdes conséquences du dérèglement climatique n’apparaissent pas dans le présent et sont à peine mentionnées dans le futur. Kira décrit vaguement une « autre moitié de la Terre » désormais inhabitable, comme un ailleurs lointain. Les seuls personnages de migrant·e·s ne sont même pas les sujets de leur propre histoire, puisqu’ils sont vus à travers les yeux de McKenzie.Une réflexion de pose à la fin du film : le public occidental ne peut-il éprouver de l’empathie que par une projection mentale dans son propre futur, au lieu d’une projection ailleurs sur la planète ? Si le long-métrage avait l’intention d’exprimer des valeurs politiques par la fiction, diversifier ses points de vue aurait été pertinent. Donner une voix à cette « autre moitié de la Terre » aurait permis de rappeler que tout le monde n’est pas égal face à la crise climatique.
*La taïga est une aire géographique qui s’étend de l’Amérique du Nord à l’Eurasie, principalement recouverte de forêts.
| Où voir Le temps ? Le film est projeté à Montréal à la Cinémathèque québécoise et au Cinéma du Parc, ainsi qu’à Québec au cinéma Le Clap. |