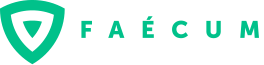Le 14 mars dernier, la doctorante en études cinématographiques Pauline Sarrazy a remporté le premier prix du concours de vulgarisation scientifique Ma thèse en 180 secondes, qui s’est déroulé à l’UdeM. Elle représentera donc l’Université à la finale nationale, qui aura lieu le 7 mai prochain. Quartier Libre s’est entretenu avec l’étudiante pour discuter de son doctorat, qui porte sur la poésie insoupçonnée des scénarios de film.
Comment le monde des études cinématographiques perçoit-il le scénario de film ?
Depuis quelques années, notamment depuis les années 1990, le regard change dans le milieu intellectuel autour de l’écriture scénaristique. Il y a une ouverture théorique pour tenter de faire reconnaître le scénario comme un texte qui a une valeur en soi, au même titre qu’une pièce de théâtre, et pour ne pas le considérer simplement comme un objet de production pour un film.
Cependant, si nous restons dans le cadre des études purement littéraires, le scénario a encore peine à trouver sa place. Sa valeur artistique n’est pas étudiée et peu reconnue ; puisqu’il est encore perçu comme un texte transitoire ne méritant pas d’avoir sa place dans les études. Sa pratique d’écriture est également souvent simplifiée, en raison des manuels d’écriture scénaristique, qui considèrent que le scénario doit avoir une écriture neutre, froide et sans style pour être le plus compréhensible possible pour le réalisateur ou la réalisatrice qui voudrait le mettre en images.
En 2023, les scénaristes d’Hollywood ont fait grève pendant plusieurs mois. Y a-t-il un lien entre cette grève et l’invisibilisation du scénario par le milieu du cinéma ?
La grève des scénaristes démontre qu’il y a une crise autour de ce texte complètement invisibilisé et inconnu. Par exemple, c’est fou de savoir qu’aux Oscars, le jury dessert le prix du meilleur scénario non pas au texte, mais à l’histoire du film. Il s’intéresse au récit, mais le scénario, ce n’est pas ça, c’est le texte qui a été écrit avant, et il est loin de ne contenir que l’histoire du film. Cette pratique participe donc à invisibiliser le travail artistique de l’écrivain scénariste, qui n’est au final jamais récompensé pour son travail d’écriture.
Comme les scénarios ont une valeur artistique, tu défends l’idée de les publier. Souhaites-tu faire publier les scénarios des films qui sont produits ou ceux qui n’ont pas la chance d’être portés à l’écran ?
Je crois que les maisons d’édition devraient publier les deux, parce que les scénarios non réalisés ont parfois une liberté artistique qui est encore plus significative, du fait qu’ils ne rentrent pas tout de suite dans la chaîne de production. Le lecteur a donc l’impression de lire le film tel qu’il a été imaginé, pensé, rêvé : sans contrainte. Publier les scénarios réalisés ou non permettrait ainsi de découvrir tout un pan de l’art cinématographique qui est encore complètement invisible, et de donner vie à plus de scénarios.
Les maisons d’édition publient pourtant les pièces de théâtre, reconnaissant ainsi que le texte a une valeur indépendante de la présentation devant un public. Pourquoi n’est-ce pas la même chose pour les scénarios ?
Il y a effectivement une reconnaissance éditoriale beaucoup plus forte pour les pièces de théâtre. Le théâtre est un art qui a été plus mis en valeur que le cinéma, parce que le cinéma a été pris d’emblée comme un art du divertissement, plutôt dénigré par les académiciens. Le théâtre, et notamment les tragédies grecques, est considéré comme un art noble, et n’a pas eu de difficulté à entrer dans le palmarès des œuvres littéraires. La pièce de théâtre mérite donc d’être lue, en plus d’être vue sur scène. Elle a été presque sacralisée dans ce contexte, alors qu’un scénario de film a suivi la logique d’un certain mépris que les académiciens avait face à l’émergence du cinématographe.
Ta thèse s’intitule À la croisée des mots et de l’image pour une poésie scénaristique. Tu y expliques, entre autres, que la poésie d’un scénario se dégage des détails de mise en scène. Pourrais-tu développer cette idée ?
L’un des objectifs de cette thèse est de démontrer que la poésie, contrairement à la poésie littéraire, peut être un outil pour la création d’un film. Par exemple, une façon de décrire la lumière va permettre de la capter avec une intention différente de la description scénaristique classique. En fait, tous les matériaux d’expression cinématographique, comme les décors et le son, vont être guidés par cette poésie et vont donner une intention et des indications de mise en scène au réalisateur ou à la réalisatrice.
Est-ce que tu pourrais donner un exemple concret ?
Oui, je pense à un extrait de la dernière scène du film L’Aurore, du scénariste autrichien Karl Mayer, annoté par F.W. Murnau en juin 1974.
Dans cet extrait, l’idée est de décrire et de personnifier la nature pour que le lecteur ait des images concrètes dans sa tête, mais aussi des intentions. Dans cet exemple, L’aurore est une histoire d’amour passionnelle, et la façon dont le scénariste décrit le lac et la lumière incarne déjà ce sentiment amoureux. Il y a donc tout un réseau poétique qui se crée et donne une intention à la mise en scène avant même que celle-ci soit portée à l’écran.
Dernière scène du film L’Aurore de Karl Mayer
UN CHEMIN DANS LES COLLINES.
Au bord d’un grand lac
C’est l’aube maintenant
Silence.
[…]
C’est l’aube, il n’y a plus que le vent
Qui remue doucement les buissons
Une lumière apparaît
C’est le soleil
Qui se lève maintenant,
Brille,
Et enflamme tout le lac de sa lumière,
Tandis que le haut de l’image est encore gris.
Les premiers oiseaux passent devant la caméra
Puis :
Nous voyons maintenant LA MAISON DU COUPLE,
Baignée par la lumière.
C’est l’AURORE.
[Elle] est maintenant rayonnante
Dans la lumière du matin,
Avec ses caisses à fleurs, dans le vent léger.
Les gouttelettes de rosée tombent des feuilles,
Tandis que le brouillard se dissipe imperceptiblement
Et que les oiseaux déjà voltigent, autour des corniches
L’image persiste quelques secondes
Puis…
GÉNÉRIQUE
La présentation Scénario et poésie : les promesses de l’improbable rencontre de Pauline Sarrazy se trouve sur YouTube.
Crédit photo : Amélie Philibert – UdeM