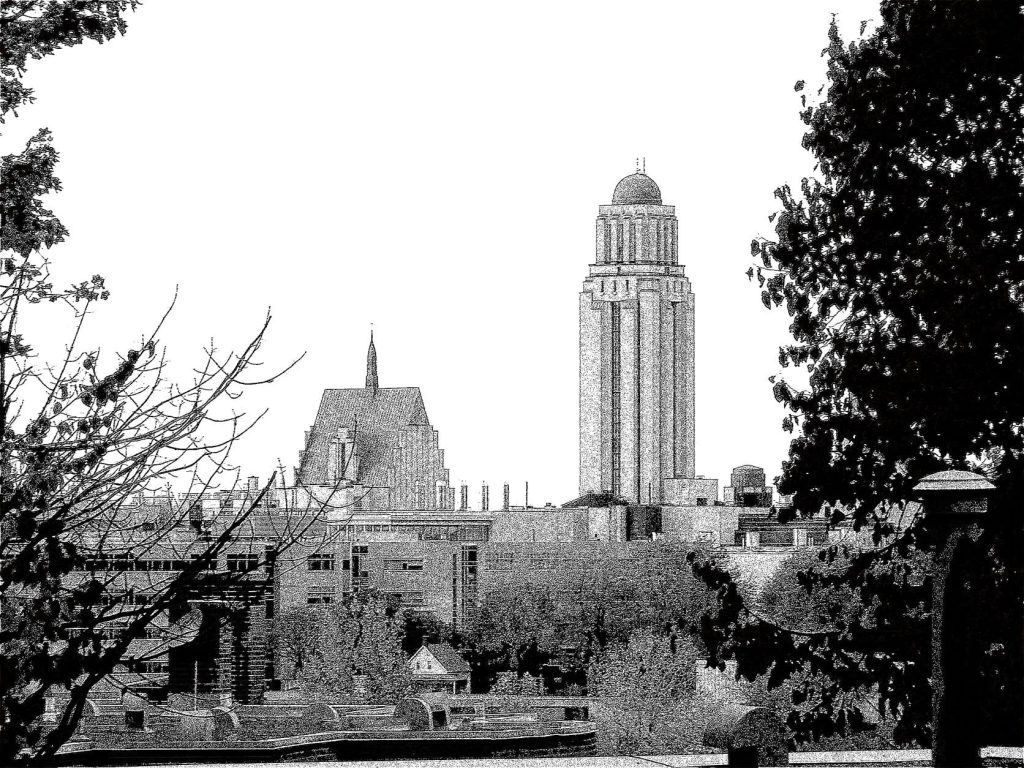« C’est tout le temps non », lance la présidente du Syndicat des employé·e·s de la recherche de l’Université de Montréal (SERUM), France Filion. Les autres syndicats rencontrés par Quartier Libre partagent ce constat et affirment se buter à des ressources humaines peu conciliantes et à des gestionnaires rigides.
Or, depuis quelques années, beaucoup de changements sont survenus dans les hautes sphères universitaires. Un nouveau rectorat et, surtout, une pandémie ont compliqué les choses.
« Ça a été un enjeu qui a amené des difficultés, je ne peux pas tout mettre sur [le dos de] l’employeur », concède le président du Syndicat des employé·e·s de l’Université de Montréal (SEUM), Nicolas Ghanty. De son côté, l’UdeM assure travailler à bâtir une bonne entente avec la nouvelle directrice générale des ressources humaines. « Karina Adam occupe son poste depuis peu, mentionne la porte-parole de l’UdeM, Geneviève O’Meara. Elle prend le pouls des différentes équipes et mène plusieurs rencontres pour se présenter, dans le but d’installer une relation de confiance. »
| Syndicats de l’UdeM |
|
Le SÉSUM représente les étudiant·e·s salarié·e·s, c’est-à-dire les auxiliaires d’enseignement ou de recherche et les assistant·e·s techniques. Le SERUM représente le personnel rémunéré par des fonds de recherche. Il se compose de trois unités : les postdoctorant·e·s, les employé·e·s de soutien et d’administration ainsi que les professionnel·le·s de recherche. Le SEEUM représente l’ensemble des employé·e·s d’entretien, par exemple les électricien·ne·s, les peintres ou les machinistes. Le SEUM représente une large partie des salarié·e·s rémunéré·e·s directement par l’UdeM. Il englobe quatre groupes : les employé·e·s de bureau, les technicien·ne·s, le personnel de « métiers et services » et les assistant·e·s techniques. D’autres corps professionnels possèdent leur propre syndicat ou association, comme les professeur·e·s (SGPUM), les chargé·e·s de cours (SCCCUM) et les cadres (ACPUM). |
La rigidité des ressources humaines et des gestionnaires dans les relations de travail est, selon plusieurs syndicats, un facteur important de la difficulté qu’ils éprouvent à résoudre conflits et négociations. Outre cette doléance commune aux syndicats rencontrés, les problèmes sont propres à chaque secteur.
Selon le président du Syndicat des employés d’entretien de l’Université de Montréal (SEEUM), Yannick Tremblay, les employé·e·s d’entretien font face à une sous-traitance grandissante. Les auxiliaires d’enseignement subiraient pour leur part des abus de pouvoir contre lesquels ils et elles n’ont que peu de recours, selon la responsable à la coordination du Syndicat des étudiant·e·s salarié·e·s de l’Université de Montréal (SÉSUM), Melila Bouarab. De leur côté, les membres du SERUM hésitent à déposer des griefs, « parce qu’ils ont peur de perdre leur emploi », selon Mme Filion, et les membres du SEUM doivent s’entendre avec des gestionnaires qui sont « rois et maîtres de leur unité de travail », estime M. Ghanty. Tous des cas individuels que l’UdeM n’a pas souhaité commenter.
Des auxiliaires vulnérables
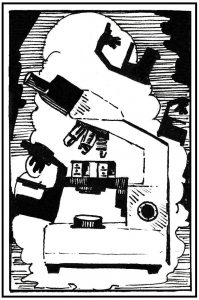
Le SÉSUM représente, entre autres, les auxiliaires d’enseignement, et a récemment commencé à négocier le renouvellement de sa convention collective. « Ça ne s’est pas très bien passé », précise Mme Bouarab à l’issue de la première rencontre de négociation, tenue le 10 février dernier.
Les demandes de ce syndicat auraient été rejetées en bloc par l’UdeM, selon la responsable à la coordination. Pourtant, selon le syndicat des étudiant·e·s salarié·e·s, les problèmes en lien avec les tâches d’auxiliariat et le nombre d’heures travaillées seraient fréquents. Mme Bouarab, elle-même étudiante à la maîtrise en anthropologie et auxiliaire de recherche à l’UdeM, rapporte, par exemple, avoir vu un auxiliaire laver la vaisselle de son professeur.
La vulnérabilité des étudiant·e·s face à leurs superviseur·e·s explique en partie ce genre d’excès, selon le SÉSUM. Dépendant·e·s des professeur·e·s pour l’obtention de leur contrat, les auxiliaires déposent peu de griefs, rapporte la conseillère syndicale, Florence Blain. « Un exemple parmi beaucoup d’autres : il est malheureusement très fréquent que les auxiliaires n’osent pas cesser de travailler lorsque le nombre d’heures de travail prévu à leur contrat est atteint, par crainte de ne plus recevoir de contrat par la suite », déplore-t-elle. Ainsi, ils et elles finissent leur travail bénévolement.
Le syndicat est d’avis que ces problèmes exigent des solutions systémiques, mais que les ressources humaines chercheraient plutôt à les régler sur une base individuelle, ce qui ferait fi de la vulnérabilité des étudiant·e·s face à leurs superviseur·e·s. « C’est vraiment une déconnexion de la réalité du terrain », se désole Mme Bouarab. L’Université a préféré ne pas commenter les relations de l’établissement avec chacun des syndicats. « L’UdeM et les différents syndicats ont chacun des mandats respectifs, assure toutefois Mme O’Meara. Elle travaille de concert vers l’atteinte d’objectifs communs, et ce, dans le meilleur intérêt de la communauté universitaire. » Mme Bouarab lui fait écho en affirmant être optimiste par rapport aux négociations à venir. « Ça avance tranquillement, mais sûrement », affirme-t-elle.
Contrer la sous-traitance
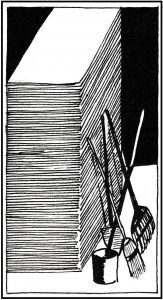
Selon Mme O’Meara, le problème de sous-traitance auquel sont confronté·e·s les employé·e·s d’entretien du SEEUM trouve son origine dans la pénurie de main-d’oeuvre, un phénomène qui touche l’ensemble de la société. L’Université recourt donc à des contractants, c’est-à-dire des entreprises extérieures qui répondent à des appels d’offres. « Plus ça va, plus il y a des entrepreneurs qui entrent ici, déclare le vice-président du SEEUM, François Dubé. C’est notre combat de tous les jours. Pour nous, la sous-traitance, c’est non négociable. Nous travaillons et nous nous battons pour des jobs. Ce sont nos jobs que nous voulons garder. C’est notre gros cheval de bataille. »
Pour contrer la sous-traitance, le SEEUM demande d’augmenter l’attractivité de l’UdeM, en rendant l’horaire des travailleur·euse·s plus flexible. Cette solution passerait notamment par la possibilité de travailler quatre jours par semaine. « C’est quelque chose qui devient à la mode, observe M. Dubé. On leur disait [à la table de négociation] qu’on pourrait faire des journées un peu plus longues. Tout ça aurait pu être négocié, mais l’établissement ne veut pas. »
De son côté, l’UdeM assure déployer les efforts nécessaires pour attirer des travailleur·euse·s. « Nous utilisons des moyens créatifs pour ce faire, assure Mme O’Meara. C’est ce qui nous permet d’être un employeur de choix année après année, et nous en sommes fiers. »
Comités, griefs et arbitres
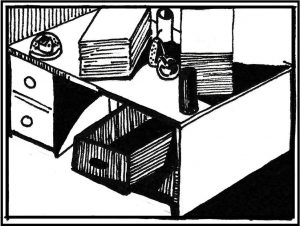
Pour le SEUM et le SERUM, les tensions avec les ressources humaines viennent d’abord et avant tout de la difficulté à résoudre les conflits de travail au quotidien. Les comités des relations du travail (CRT) sont les premières instances à travers lesquelles les employé·e·s et les gestionnaires peuvent résoudre leurs différends à l’amiable. Toutefois, les CRT semblent dysfonctionnels aux yeux des deux syndicats. « Notre constat, affirme M. Ghanty, c’est qu’au bout des échanges, il ne semble pas y avoir d’ouverture pour changer les méthodes. » Mme Filion, du SERUM, fait le même constat et espérait régler en CRT des litiges non encadrés par les conventions collectives. « Il y a zéro ouverture pour parler de problèmes qui ne sont pas dans la convention collective », regrette-t-elle.
Résultat : les appels aux CRT ne se font plus et le dépôt de griefs (voir encadré) devient la seule option. Or, au SERUM, peu de griefs seraient déposés, entre autres parce que les postdoctorant·e·s sont, à l’instar des auxiliaires d’enseignement, dépendant·e·s de leurs superviseur·euse·s pour leur emploi. Trop vulnérables pour le processus de griefs et ignoré·e·s dans les CRT, ils et elles ont peu d’avenues pour faire changer les situations jugées problématiques à leurs yeux, soutient Mme Filion.
Au SEUM, l’inefficacité des CRT explique la multiplication des griefs, selon M. Ghanty : les membres de son syndicat déposent en moyenne 100 griefs par année, contre 20 à 30 pour leurs homologues d’autres universités québécoises. Et puisque ce syndicat et les ressources humaines ne trouvent pas toujours un terrain d’entente, une bonne partie de ces griefs se rendent en arbitrage (voir encadré), un processus juridique coûteux. « Si on prend l’ensemble des griefs qu’on a mis à l’arbitrage depuis la signature de la convention collective [NDLR : En 2021], on en a pour environ 200 000 $ de coûts d’arbitrage », souligne M. Ghanty.
Optimisme et exaspération
| Démystifier le jargon des relations de travail |
|
Une convention collective est un contrat entre un syndicat et l’employeur qui encadre, entre autres, les conditions de travail (rémunération, congés, santé et sécurité). Elle est d’une durée limitée et doit être renouvelée lorsqu’elle est échue. Un comité des relations du travail (CRT) est une instance où le syndicat et l’employeur règlent à l’amiable les litiges formulés par l’un ou l’autre. L’employeur est souvent représenté par ses ressources humaines. Un grief est une plainte formulée à l’employeur par le syndicat et concerne l’application de la convention collective. Celui-ci survient également lorsque les discussions en CRT n’ont pas permis de trouver un terrain d’entente sur un litige particulier. Une procédure d’arbitrage peut être enclenchée lorsque le délai pour régler un grief est écoulé. Un arbitre indépendant est chargé de régler le grief et sa décision est finale. |
Ces dépenses semblent être le résultat d’une attitude contradictoire aux ressources humaines, d’après M. Ghanty. D’un côté, celles-ci feraient part d’une intransigeance vis-à-vis des employé·e·s : « C’est toujours la ligne : « Nous, on a pris cette décision-là » », affirme-t-il. De l’autre côté, il y aurait, selon lui, un laxisme envers des gestionnaires : « Un manque de contrôle sur ce que les gestionnaires font et sur les conséquences que cela peut avoir. Ils ne sont pas imputables et c’est peut-être pour ça qu’on a de la difficulté à régler certains dossiers. »
Ce cul-de-sac n’est pas inévitable, d’après le président du syndicat des employé·e·s d’entretien M. Tremblay. « Il y a de nouveaux gestionnaires avec une nouvelle mentalité qu’on trouve très agréable, rafraîchissante », se réjouit-il. Parmi eux, Sébastien Richer, nouvellement directeur de la Division des services à la communauté. Ensemble, le SEEUM et lui ont résolu une centaine de griefs en quelques rencontres, selon M. Dubé. Pour M. Richer, la solution semble évidente. « Il ne faut pas être avare et il faut laisser son orgueil de côté, estime-t-il. Il faut prendre des décisions dans l’optique où les employés doivent être heureux au travail et l’employeur être performant. Il faut mettre les gants de boxe de côté. »
Tout le monde ne partage pas cet optimisme. Mme Filion, qui préside le SÉRUM depuis 13 ans, a un point de vue légèrement différent. « Oui, je pourrais dire que l’Université de Montréal manque d’initiative, admet-elle. C’est une grosse université qui reçoit beaucoup de fonds de recherche. J’aimerais bien qu’elle fasse preuve de plus de leadership. J’aimerais beaucoup. »
En collaboration avec Paul Fontaine