Le programme de maîtrise qualifiante en enseignement de l’UdeM doit s’adapter à la réalité
professionnelle et personnelle de ses étudiant·e·s, en plus de répondre à la pénurie alarmante
d’enseignant·e·s. Quartier Libre s’est penché sur la question.
« Des universités du Québec peinent à retenir jusqu’à l’obtention de leur diplôme les enseignants non
légalement qualifiés y ayant entamé une maîtrise qualifiante », a révélé une enquête du journaliste
Zacharie Goudreault intitulée Les étudiants à la maîtrise en enseignement sont à bout de souffle publiée
dans Le Devoir le 22 octobre dernier.
Au milieu des années 2000, le gouvernement québécois a créé la maîtrise qualifiante en enseignement
pour répondre à la pénurie d’enseignant·e·s dans les écoles primaires et secondaires de la province. Ce
programme de 60 crédits universitaires permet aux enseignant·e·s non légalement qualifié·e·s d’obtenir le
brevet d’enseignement normalement requis pour exercer leur travail. À temps plein, cette formation
s’effectue en deux ans, contre quatre pour le baccalauréat en enseignement, et permet donc de former plus rapidement de nouveaux·elles enseignant·e·s.
Un long parcours
« Le degré d’engagement et les ressources financières et humaines requises pour cette maîtrise sont très
grands, surtout pour une professionnelle comme moi, qui cumulait près de 20 ans d’expérience dans une
autre carrière, qui a une famille et une charge financière considérable », souligne l’étudiante à la
maîtrise qualifiante en enseignement de l’UdeM depuis septembre 2021 Christine Girard.
Elle envisage de terminer ses études en 2025 et aura donc effectué son programme en quatre ans pour
enfin obtenir son brevet d’enseignement.
Mme Girard, qui enseigne à temps plein dans une école primaire depuis septembre 2024, confie qu’elle
opterait « fort probablement » pour un programme court si elle commençait ses études aujourd’hui.
Pour la doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation de l’UdeM, Ahlem Ammar, les programmes
courts ne constituent toutefois pas la solution à la pénurie d’enseignant·e·s. « La recherche prouve que les
diplômés [de ces programmes] sont mal formés et plus à risque de quitter la profession », explique-t-elle.
Valoriser les acquis expérientiels
Depuis juillet 2024, la Faculté des sciences de l’éducation de l’UdeM détient une autorisation permanente
du ministère de l’Éducation pour offrir le programme de maîtrise qualifiante en enseignement. Ce
nouveau statut donne désormais la possibilité à la Faculté de repenser certains éléments du cursus, précise Mme Ammar.
« On pourrait éventuellement reconnaître des crédits à l’admission et pendant le parcours pour
l’optimiser, poursuit la doyenne. Présentement, les acquis expérientiels ne sont reconnus qu’aux fins d’admission, quand la moyenne exigée n’est pas atteinte, mais on travaille fort là-dessus. »
En effet, plusieurs étudiant·e·s inscrit·e·s dans ce programme travaillent à temps plein dans une école
depuis plusieurs années. Les exempter de certains stages et cours théoriques serait donc logique.
Vers plus de flexibilité ?
« Depuis le mois de juillet, il y a des nouveautés chaque mois, constate le responsable de programme de la maîtrise qualifiante en enseignement au secondaire, Alejandro Gonzalez-Martin. On essaye de maximiser la formation en adoptant plusieurs mesures. »
La Faculté réfléchit à une façon d’offrir plus de flexibilité à ses étudiant·e·s, par exemple en révisant le
nombre de cours préalables pour faire les stages. M. Gonzalez-Martin estime qu’elle pourrait
potentiellement demander aux étudiant·e·s d’avoir uniquement suivi les cours « vraiment essentiels », afin
de ne pas les bloquer dans leur parcours.
Le manque de flexibilité du programme actuel a, en effet, contraint Mme Girard à suivre davantage de
cours par trimestre qu’elle ne l’aurait souhaité. « Pour réaliser mon dernier stage cet hiver, je devais avoir
complété tous les autres crédits… ce qui me force à suivre trois cours cet automne », déplore-t-elle.
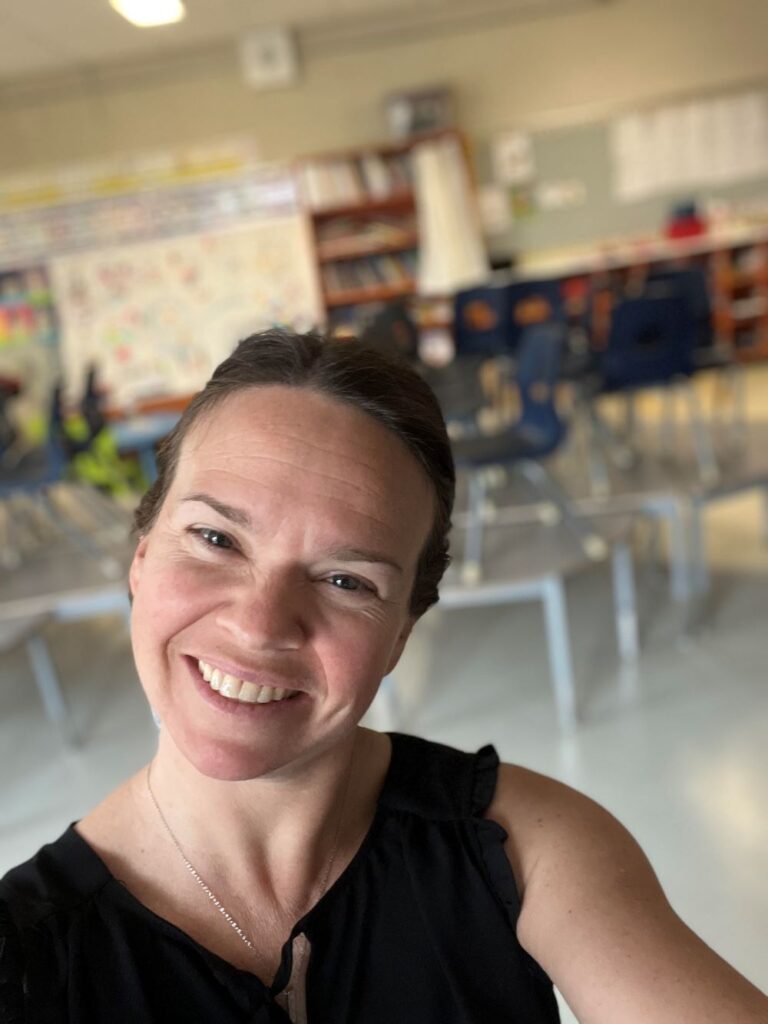
Des stages en situation d’emploi salvateurs
Depuis janvier 2024, la Faculté admet les stages en situation d’emploi, ce qui constitue un « grand
soulagement » pour les étudiant·e·s qui enseignent déjà, explique M. Gonzalez-Martin. En effet, jusqu’à
récemment, ces dernier·ère·s devaient quitter leur emploi dans une école pour effectuer leur stage dans
une autre, et ce, sans rémunération. Cette nouvelle possibilité règle donc des problèmes à la fois d’ordre
financier pour les étudiant·e·s-enseignant·e·s et pédagogique pour les élèves.
Le responsable du programme explique que la structure de la maîtrise qualifiante était tirée de celle du
baccalauréat en enseignement, qui invite les étudiant·e·s à faire des stages dans des milieux différents. «C’est très bien, mais pas adapté à la réalité de la maîtrise qualifiante et de la pénurie d’enseignants »,
ajoute-t-il.
L’urgence d’agir
En réponse à l’essoufflement des étudiant·e·s que met en lumière l’enquête du Devoir, la doyenne insiste
sur l’importance de remettre les pendules à l’heure.
« Tout le monde est essoufflé, pas juste les étudiants inscrits à cette maîtrise, alerte-t-elle. Tout le monde
qui évolue dans le milieu de l’enseignement en ce moment est épuisé. »
En outre, selon Mme Ammar, la durée de la maîtrise n’explique pas la baisse du taux de diplomation. Bien
que ce paramètre y contribue, les conditions de travail difficiles dans les écoles constituent également un
facteur de fatigue important.
Les taux de rétention et de diplomation sont d’ailleurs les mêmes que ceux d’autres programmes de
maîtrise qui débouchent vers des secteurs qui ne sont pas touchés par une pénurie de main-d’œuvre.
« Un travail collectif »
M. Gonzalez-Martin abonde dans le même sens. « Nous sommes tous dans l’urgence, mais nous voulons
prendre des décisions pérennes, affirme-t-il. C’est une situation difficile, nous faisons face à un cercle
vicieux dans lequel il faut former des enseignants rapidement, mais les écoles ne peuvent pas libérer leurs enseignants non légalement qualifiés pour leur donner le temps de se former correctement et obtenir leur brevet. »
Selon lui, la solution se trouve dans un « travail collectif ». Il estime que le système d’éducation doit
réfléchir à la façon d’accompagner ces personnes pour assurer leur réussite et leur épanouissement. À
l’heure actuelle, des programmes de mentorat existent, mais ils ne sont pas toujours offerts en raison d’un manque de ressources.
Mme Girard, qui approche de la fin de son parcours, confie pour sa part que la meilleure voie pour elle
aurait été « une formule misant sur la concordance entre les cours et le travail dans une école ».

