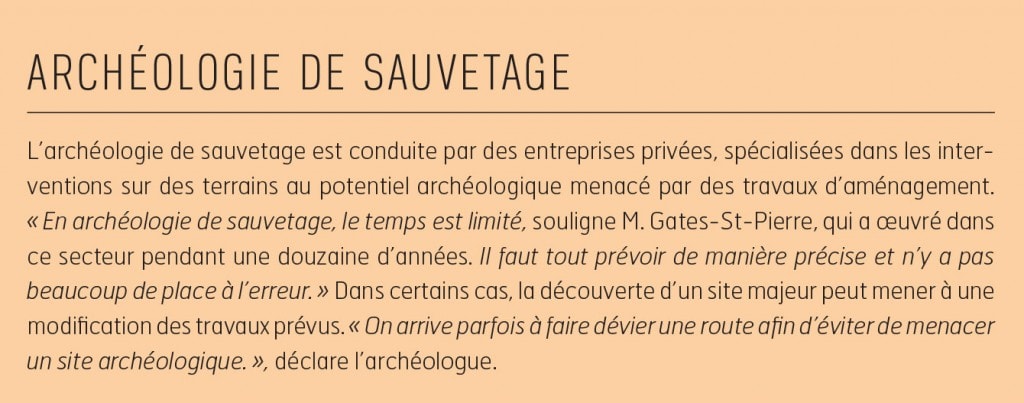«L’archéologie collaborative permet d’ouvrir la science aux communautés concernées par les recherches et de les impliquer dès le départ, affirme le professeur au Département d’anthropologie de l’UdeM Christian Gates St-Pierre. Il explique qu’avant même d’élaborer un projet de recherche, les archéologues rencontrent les communautés pour déterminer les termes de leur collaboration.
« L’archéologie collaborative est une sorte de mea-culpa, on reconnaît qu’on n’a pas fait de la bonne archéologie par le passé. » Christian Gates St-Pierre Professeur au Département d’anthropologie de l’UdeM
Selon M. Gates St-Pierre, cette façon de procéder permet d’établir une relation de confiance entre les populations visées et les archéologues, ce qui n’a pas toujours été le cas. « Dans le passé, les archéologues se contentaient de communiquer les résultats de leurs recherches, ce qui n’est plus suffisant, estime-t-il. Faire place aux communautés dans le processus de recherche leur permet de se réapproprier leur passé. C’est leur patrimoine, après tout. »
Spécialisée en archéologie publique, la professeure au Département d’anthropologie de l’UdeM Katherine Cook offre une analyse plus brute. « L’archéologie a une histoire très coloniale, une histoire problématique où on a tirer avantage de beaucoup de communautés, on a volé beaucoup d’objets, on a fouillé des sites qu’on n’aurait pas dû fouiller, concède-t-elle. Mais en travaillant de façon plus collaborative, plus ancrée dans des communautés, c’est une opportunité de transformer un système de pouvoir qui a longtemps privilégié l’archéologie. »
Projet « Tiohtià : ke »
Le projet Tiohtià : ke, auquel participent M. Gates-St-Pierre et Mme Cook est un exemple d’archéologie collaborative. Tous deux ont été approchés par la communauté mohawk de Kahnawake afin d’étudier le passé autochtone de la région de Tiohtià : ke, rebaptisée Montréal par les Européens. Dès le début du projet, les représentants mohawks ont signalé leur intérêt à documenter l’histoire de leur communauté, une histoire transmise par voix et tradition orale. « Cette tradition orale viendra compléter l’archéologie, et il est possible qu’au final, on ait deux discours qui s’opposent, relate M. Gates St Pierre. On se permet l’idée qu’on ne sera pas nécessairement d’accord à la fin, mais dans tous les cas, on va quand même publier les deux côtés de la médaille. »
Cette double perspective sur le passé n’aurait pas pu voir le jour sans l’apport du savoir traditionnel de la communauté mohawk. « L’archéologue ne devrait pas rester dans sa tour d’ivoire à l’université ou dans un musée, croit Mme Cook. Il n’y a pas qu’une seule façon de comprendre le passé, et on apprend beaucoup en travaillant ensemble. »
Questions éthiques
Dans son document Normes et directives à l’intention de l’archéologue-conseil (2011), le ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l’Ontario oblige les archéologues titulaires d’une licence à collaborer avec les collectivités sur les sites autochtones. Le vice-président à l’éthique et aux standards de l’Association des archéologues du Québec (AAQ), Martin Perron, souligne qu’une telle mesure coercitive n’existe pas au Québec.
« On encourage fortement nos membres à collaborer avec les communautés autochtones ou les groupes d’intérêts qui pourraient être associés aux fouilles archéologiques, affirme M. Perron. Il concède toutefois que dans la pratique, ce n’est pas toujours quelque chose d’évident à réaliser. « Certaines communautés sont plus ouvertes, d’autres plus méfiantes, selon M. Perron. Ça dépend aussi des processus internes des communautés, certaines ont déjà des archéologues associés. »
Si Mme Cook convient que la réalisation de ces collaborations dépend du contexte, elle estime que ce processus est essentiel aujourd’hui à la conception de recherches éthiques et pertinentes. « Je ne peux imaginer aucune recherche au Québec, et plus généralement au Canada, qui ne nécessiterait ni de collaboration avec les communautés ni d’engagement et de sensibilisation du public, souligne-t-elle. Les organisations doivent être des moteurs de changement pour démocratiser l’archéologie, et elles doivent pousser leurs membres à être des archéologues éthiques, responsables et respectueux ». Mme Cook est témoin d’un changement de mentalité au sein des associations professionnelles d’archéologie, mais dit rester impatiente.
Un outil de réconciliation
L’AAQ procède actuellement à une refonte de son code d’éthique, mais seul le ministère de la Culture et des Communications du Québec a le pouvoir de légiférer en matière d’archéologie. « L’archéologie collaborative n’est pas un effet de mode, elle participe à un processus de réconciliation au niveau national, soutient M. Perron. Il est temps de redonner une voix aux Premières Nations. On traite directement de leur passé, alors aussi bien les impliquer dans l’interprétation et la mise en valeur de ce passé. »
M. Gates-St-Pierre partage cet avis. « Ces populations ont longtemps été ignorées, explique-t-il. L’archéologie collaborative est une sorte de mea-culpa, on reconnaît qu’on n’a pas fait de la bonne archéologie par le passé, mais depuis une dizaine d’années, les attitudes changent. »
Selon lui, l’intégration des savoirs traditionnels des communautés à l’archéologie a suscité son lot de craintes dans les cercles anthropologiques canadiens. « On a eu une peur égoïste de perdre notre monopole du discours sur le passé lointain, reconnaît-il. En intégrant notamment la tradition orale, on avait peur de perdre le contrôle, mais avec le temps, ces craintes se sont avérées non fondées. » Il assure également ne voir que du positif à travailler avec les Premières Nations.
Une pratique qui captive les étudiants
Mme Cook développe des cours au premier et au deuxième cycle ainsi que des postes pour des étudiants au doctorat qui s’orienteront vers l’archéologie collaborative et communautaire. « On constate que c’est une spécialisation qui prend de plus en plus de place, surtout pour les nouvelles générations, déclare-t-elle. Je n’ai pas à leur vendre l’idée de travailler main dans la main avec des communautés. L’archéologie se diversifie et les jeunes sont prêts à travailler de cette façon. » Pour M. Gates-St-Pierre, l’embauche de Mme Cook en juin 2018 reflète l’ouverture du Département d’anthropologie de l’UdeM face à l’archéologie communautaire.
De descendance huronne-wendate, Pier-Louis Dagenais-Savard n’avait jamais envisagé une carrière d’archéologue avant que son conseil de bande lui offre un poste de surveillant de chantier sur un site de fouilles. « J’ai tout de suite eu la piqûre, affirme celui qui est maintenant étudiant à la maîtrise en anthropologie à l’UdeM. J’avais l’impression de redonner à ma nation, qui m’a toujours appuyé, et en plus, de collaborer avec des archéologues. On a rencontré d’autres nations autochtones et on a créé des liens. » Il confie ressentir la responsabilité et l’urgence de conserver les cultures et de les partager. Avec ses connaissances anthropologiques, M. Dagenais-Savard espère contribuer positivement à sa communauté.