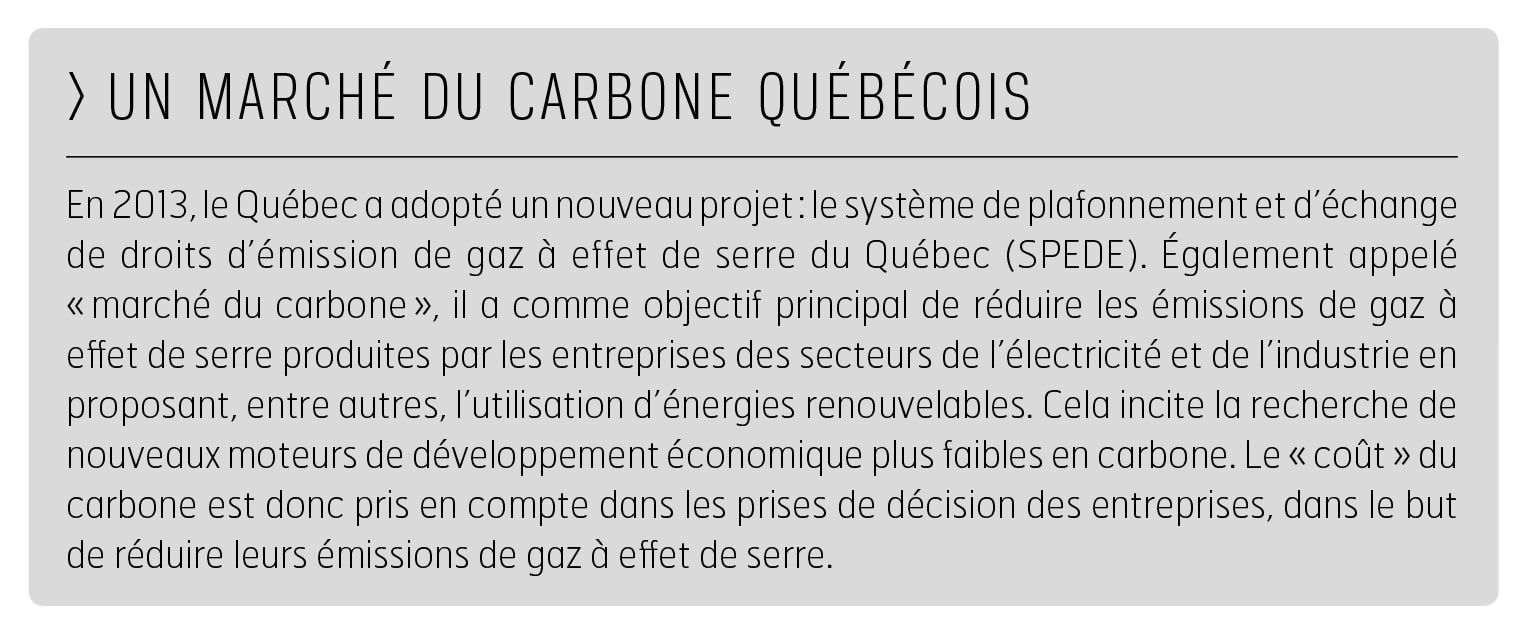Quartier Libre : Qu’est-ce que la séquestration du carbone par les forêts ?
Xavier Cavard : Il y a différents termes utilisés. Nous pouvons parler aussi de captation ou de stockage. C’est le fait que la végétation de la forêt va naturellement capter le carbone atmosphérique par la photosynthèse. Quand la végétation meurt, une bonne partie de ce carbone se retrouve dans les sols. Étant donné les conditions climatiques froides de la forêt boréale, la décomposition est très lente, il y a donc un très gros réservoir de carbone qui reste dans les sols.
Q. L. : Concrètement, comment l’industrie forestière peut-elle optimiser le stockage de carbone dans la forêt ?
X. C. : En fait, il y a deux voies principales pour augmenter la séquestration du carbone dans les forêts aménagées. La première passe par la maximisation de la productivité des tiges. Le carbone capté par les arbres peut alors, après la récolte, être stocké plus ou moins longtemps dans les produits du bois. Il est possible d’optimiser cette technique par un entretien intensif de la forêt, qui implique de la préparation de terrain, en retournant le sol pour favoriser la décomposition, et la plantation d’espèces plus productives. Ce genre de pratique poserait évidemment des problèmes dans le maintien de la biodiversité de nos forêts, sans compter la perte probable d’une partie du carbone contenu dans la matière organique des sols. De plus, ce n’est pas économiquement envisageable de déployer ce genre d’opérations coûteuses sur l’ensemble du territoire forestier québécois.
La solution envisagée est donc de compenser ces zones d’aménagement intensif avec d’autres dites écosystémiques, à savoir un aménagement qui tente de se rapprocher des perturbations naturelles. Cela implique notamment des opérations plus légères, comme des coupes partielles, qui visent à moins perturber les sols. Cela permet de conserver la biodiversité et le réservoir de carbone dans les sols.
Q. L. : Pourquoi mettre en place une collaboration entre la foresterie et les industries minières et métallurgiques ?
X. C. : La province a instauré un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE), lié à ce qu’on appelle le marché du carbone (voir encadré). Le problème est, qu’à l’heure actuelle, la forêt n’est pas incluse dans ce système. Notre but est donc de rassembler le plus de connaissances pour démontrer que l’industrie forestière peut contribuer à compenser les émissions de gaz à effet de serre, dans ce cas-ci, des industries minières et métallurgiques de la Côte-Nord. L’objectif est d’inciter les pouvoirs publics à mieux inclure l’industrie forestière et à lui donner des incitatifs financiers pour changer son type d’aménagement et permettre de limiter les changements climatiques, mais aussi de s’y adapter. Finalement, c’est donner davantage de marge de manœuvre à l’industrie forestière. Pour nous, les écologistes, c’est intéressant, parce que ça permet de monétiser autre chose dans la forêt que le bois, à savoir le carbone.
Q. L. : Comment les chercheurs conservent-ils leur liberté universitaire en faisant affaire avec des industries ?
X. C. : Je ne pense pas avoir de pression pour obtenir certains résultats. C’est sûr que le système de financement nous incite fortement, ou nous oblige même parfois, à avoir des partenariats industriels. Les conséquences de cette alliance sont assez subtiles. Cela peut orienter le type de recherche et les sujets que nous allons traiter, en fonction des intérêts particuliers des industries. Ce financement, qui est en partie privé, peut avoir ce côté négatif. Nous essayons de faire financer nos projets par les sources appropriées en fonction du domaine de recherche. Lorsque les financements sont publics, on en profite pour essayer de faire passer des projets qui sont plus obscurs pour les milieux économiques. Pour les projets qui ont des applications un peu plus concrètes, on utilise les canaux habituels.
Q. L. : Comment pensez-vous ancrer ce projet dans la réalité économique locale ?
X. C. : En ce moment, nous manquons de connaissances. Nous sommes dans la phase de recherche. Ça va être difficile d’avoir des applications concrètes assez rapidement. En fonction des résultats de nos recherches, nous serons sûrement en mesure d’obtenir des informations intéressantes pour l’industrie forestière dans les prochaines années. Par exemple, nous allons expliquer qu’en faisant tel type d’opération forestière sur tel type de territoire, ça va avoir telle répercussion sur le bilan carbone de la forêt à long terme.
Du côté des industries émettrices, leur volonté est de pouvoir compenser leurs émissions de gaz à effet de serre localement, plutôt que d’aller acheter des réductions d’émission en Californie, par exemple, comme c’est le cas actuellement. Pour ces objectifs-là, il va falloir attendre que la législation évolue, c’est donc une vision à plus long terme. Mais pour eux, ce projet, c’est aussi l’occasion de favoriser le développement d’un nouveau pôle de recherche dans la région. Plus nous aurons un soutien financier de leur part, plus nous allons pouvoir nous agrandir, faire venir des étudiants diplômés, des chercheurs et des collaborateurs. Un des objectifs est vraiment d’amener plus de chercheurs à Sept-Îles pour contribuer à augmenter la visibilité de ce domaine encore peu développé.
Q. L. : Est-il difficile d’attirer des étudiants et des chercheurs en région ?
X. C. : C’est sûr que comme nous ne partons pas de grand-chose, c’est difficile. Il n’y a pas d’université, il y a moins de vie collective, c’est un défi d’attirer du monde. Nous avons deux étudiants au doctorat qui viennent dans notre équipe cet été, un Marocain et un Népalais. Ce sont surtout des étudiants étrangers. Malheureusement, il y a assez peu de Québécois qui déposent leur candidature pour des doctorats dans des destinations éloignées. Actuellement, l’équipe de chercheurs est assez multiculturelle, et elle va continuer de l’être.