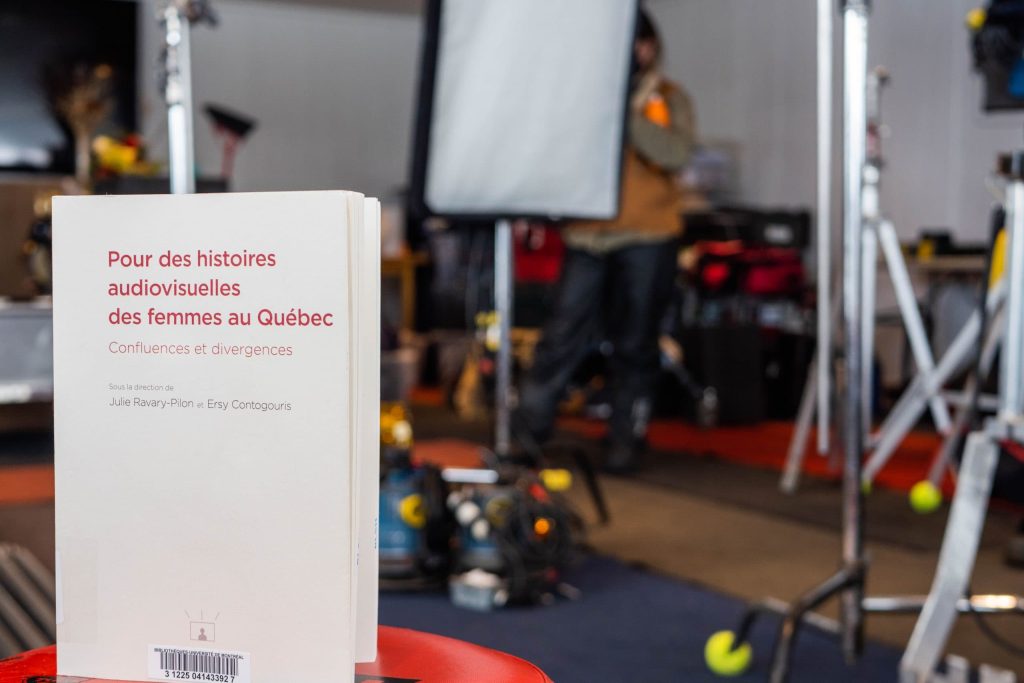Julie Ravary-Pilon est chargée de cours au Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université de Montréal. Elle enseigne le cours de «Cinéma, genre et sexualité» aux étudiant·es de premier cycle. Durant son doctorat, elle s’est spécialisée dans l’étude des identités sexuelles et de genre dans les médias.
Ersy Contogouris est historienne de l’art et professeure agrégée au Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université de Montréal. Ses recherches portent sur les approches féministes et queer en histoire de l’art des XVIIIe et XIXe siècles. Elle étudie notamment l’histoire de la caricature et de la satire graphique.
Quartier Libre (Q. L.) : Comment avez-vous conçu le livre ?
Julie Ravary-Pilon (J. R.-P.) : J’avais fait un colloque de trois jours à la Cinémathèque, en 2018, dont le sujet était «Être femme dans les médias audiovisuels au Québec : cinéma, télévision, jeux vidéo, Web». J’ai invité les collaborateurs à poursuivre la réflexion dans cet ouvrage. J’avais déjà rencontré Ersy et je me suis tournée vers elle, car j’apprécie sa pensée critique et son travail en général. Elle a amené une plus grande perspective.
Q. L. : Comment avez-vous déterminé les sujets du livre ?
J. R.-P. : Notre but a été de parler d’enjeux transversaux, avec une idée de «transmédialité». On a essayé d’intégrer le plus de domaines possible?: cinéma, télévision, vidéo et jeux vidéo, sexologie, communication, littérature, avec des personnes provenant de différents milieux. On voulait que les histoires soient plurielles et que les postures politiques soient variées, d’où le sous-titre Confluences et divergences.
Q. L. : Le dernier chapitre de votre livre porte sur l’archivage des œuvres audiovisuelles. Pouvez-vous nous parler de cet enjeu ?
J. R.-P. : Dans les médias audiovisuels, les supports changent tout le temps et c’est très cher de garder une caméra en bon état. L’accès aux archives pour que les artistes et le public puissent s’en inspirer est un enjeu fondamental [pour la représentativité]. Par exemple, ça a été difficile de rendre disponible le premier long métrage de fiction réalisé par une femme [Mireille Dansereau] au Québec. Celle-ci l’aborde d’ailleurs dans une entrevue qu’on retrouve dans le livre. […] La question en fait est de savoir comment les infrastructures peuvent nous permettre de garder vivante la mémoire du féminisme dans l’audiovisuel.
Ersy Contogouris (E. C.) : Actuellement, on est dans le phénomène inverse en matière d’accessibilité : avant, on avait peu de sources disponibles dans les archives. Maintenant, c’est le contraire : la quantité phénoménale de contenu qu’on retrouve sur le Web représente un important travail d’archives.
Q. L. : Comment concevez-vous la dynamique entre art et société ?
E. C. : Je ne suis pas d’accord quand j’entends que l’art est le reflet de la société. Pour parler d’art, sous n’importe quelle forme, il faut prendre position dans un débat. Certes, l’art contribue à construire une vision de la société, mais ça va dans les deux sens, c’est un dialogue constant. On peut choisir les œuvres qu’on veut pour faire passer une idée ; il y a énormément de choses misogynes qui sont réalisées, dont on a choisi de ne pas parler. La même histoire peut se raconter de plusieurs façons.
Q. L. : Que pensez-vous des mesures mises en place pour avoir une plus grande diversité dans la sphère audiovisuelle et la parité des genres ?
J. R.-P. : Je peux me positionner sur la question de la parité homme-femme. Pour les autres enjeux, je laisserai la parole aux personnes concernées. La question de la diversité traverse d’ailleurs le livre. Les mesures pour la parité, la diversité et l’inclusion, qui sont arri en 2016, ont donné un grand coup de pouce. Aujourd’hui, il y a des artistes qui les remettent en question et qui se demandent si on n’invisibilise pas d’autres démarches, et c’est vrai qu’il faut garder un œil sur les mesures mises en place et sur leurs imperfections. Mais il y a vraiment eu un changement important grâce à celles-ci, comme on le note avec une analyse quantitative, par exemple avec les deux films de Louise Archambault [Merci pour tout (2019) et Il pleuvait des oiseaux (2019)], qui ont atteint le seuil du million de spectateurs, ou le film 23?décembre (2022) d’India Desjardins, qui raconte une histoire de Noël intersectionnelle.
Je suis «Les réalisatrices équitables» depuis longtemps et elles continuent à se poser des questions à ce sujet. Qu’est-ce qu’on entend par parité ? Est-ce la personne derrière la caméra, la directrice photo, la monteuse ? Il y a aussi la question de la répartition des budgets. Et les personnes non binaires : comment sont-elles prises en compte?
E. C. : On ne demande jamais à un homme blanc s’il est là parce que c’est un homme blanc, hétéro, cisgenre. Et le but des quotas, il faut le rappeler, c’est justement qu’on n’en ait plus besoin. D’après moi, cela a permis d’amener un plus grand intérêt pour des histoires qui représentent la diversité de la société, à travers des films réalisés par des femmes autochtones, par exemple. On peut le voir dans le livre avec la réalisatrice Kim O’bomsawin [Je m’appelle humain]
Q. L. : D’après vous, à quels niveaux peut-on agir dans la société pour qu’il y ait une meilleure représentation de la diversité dans les médias audiovisuels ?
J. R.-P. : Je pense que c’est à travers l’éducation. On oublie souvent le jeune public. Cette année, dans mon cours, j’ai montré le film d’animation J’aime les filles de Diane Obomsawin, qui s’adresse à un plus jeune public, et qui raconte une histoire d’amour entre deux femmes. La tolérance, l’engagement et le respect sont des valeurs qui peuvent être enseignées très jeunes en utilisant l’art et les médias
E. C. : C’est important également dans l’éducation d’encourager l’ouverture d’esprit, la curiosité, la découverte de choses moins connues, plutôt que de toujours chercher à être conforté, ce qui est d’ailleurs l’enjeu des réseaux sociaux.
Q. L. : Vous enseignez à l’université, avec des étudiants qui travaillent sur les enjeux de demain. Avez-vous remarqué une différence au cours des dernières années dans vos groupes, et si oui, lesquelles ?
J. R.-P. : En 2017, il y a eu la création de la mineure en études féministes, des genres et des sexualités à l’UdeM, qui est venue d’un mouvement étudiant dont j’ai fait partie. Ce programme a assuré un espace intellectuel autour duquel on pouvait se rassembler à l’Université. Dans mes cours aujourd’hui, je remarque que les étudiants émettent des pensées claires, qu’ils et elles sont capables d’être à l’écoute, de remettre en question les pensées de leurs collègues sans leur manquer de respect. On ne peut pas arriver en cours en pensant rester dans nos pantoufles, on est là pour apprendre aussi. Je reviens à Roxane Gay qui disait : «Dans ma salle de cours, vous allez peut-être être confrontées, vous serez mal à l’aise parfois, mais vous ne serez jamais tourmentées».
E. C. : Je remarque d’abord un intérêt grandissant pour les enjeux liés au féminisme intersectionnel [voir encadré]. Il y a des choses qui sont maintenant tenues pour acquises, comme le «savoir situé» [voir encadré]. Maintenant, certains enjeux sont évoqués par les étudiants, sans que j’aie besoin de les soulever. Il y a aussi de plus en plus un intérêt pour tout ce qui n’est pas occidental, et c’est intéressant de voir comment l’art et le cinéma sous toutes leurs formes ont contribué à cet intérêt. Les étudiants amènent aussi beaucoup plus leurs propres expériences dans la salle de classe, ainsi que les corpus qu’ils et elles côtoient, que ce soit dans la publicité ou dans les espaces publics
Q. L. : Quelle suite souhaitez-vous donner au livre ?
J. R.-P. : L’idée est de continuer à avancer ensemble, de prendre ce qui a fonctionné ou pas et de s’en inspirer pour construire la suite. On espère vraiment que dans cinq ou dix ans, quelqu’un va reprendre le flambeau et écrire de nouvelles histoires des médias audiovisuels.
|
MESURES PARITAIRES En 2016, l’Office national du film (ONF) s’était engagé à ce que, d’ici 2019, la moitié de ses productions soit réalisée par des femmes, et à ce que la moitié des budgets de production soit allouée à des projets de réalisatrices. En 2017, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) avait dévoilé un plan d’action pour atteindre la parité des genres d’ici 2020. En 2020, Téléfilm Canada s’est engagé envers une industrie plus représentative des communautés racisées et autochtones. |
|
QUELQUES MOTS-CLÉS Le savoir situé, ou la connaissance située, est une notion conceptualisée par la biologiste et philosophe féministe Donna Haraway en 1988. La connaissance située suppose de s’interroger sur la position de la personne qui produit la connaissance, sur les limites de sa vision ainsi que sur les relations de pouvoir dans lesquelles elle s’inscrit. (Source : moisdugenre.univ-angers.fr) L’intersectionnalité est une théorie féministe qui analyse les différentes formes d’oppression et les hiérarchies de pouvoir. En plus du genre, elle prend en compte plusieurs facteurs sociodémographiques et elle examine comment ces facteurs peuvent interagir de façon simultanée. (Source : thecanadianencyclopedia.ca) |