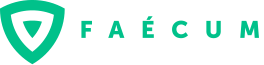Dans le dernier numéro de son magazine, Quartier Libre a sondé plusieurs personnes sur le projet de loi 83, qui vise à contraindre les nouveaux·elles médecins à travailler cinq ans dans le réseau public de la santé et des services sociaux du Québec. Depuis, la Conférence des doyens des Facultés de médecine du Québec a présenté son mémoire lors de la commission parlementaire, qui a eu lieu le 6 février dernier. Quartier Libre s’est entretenu avec le doyen de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, Patrick Cossette, pour en savoir davantage.
Quartier Libre (Q. L.) : quel est votre rôle, en tant que doyen de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal ?
Patrick Cossette (P. C.) : un doyen est responsable des activités d’enseignement et de recherche de la Faculté. Je suis responsable d’engager les professeurs, de mettre en place les programmes d’enseignement, de faire leur suivi, de recruter des étudiants et de m’assurer que ces derniers atteignent les objectifs pédagogiques qui sont évalués. Dans le cas de la médecine, beaucoup de programmes sont sous agrément, ce qui veut dire qu’il faut aussi gérer les relations avec les partenaires externes, comme le Collège des médecins du Québec, ou avec les organismes d’agrément pour s’assurer que les programmes sont conformes. Le troisième volet que je poursuis, c’est le retour vers le citoyen. C’est un élément qui est très important. Je dirais qu’il est dans l’ADN de la Faculté de médecine : nos actions doivent répondre aux besoins sociétaux et nos activités, qu’elles soient en recherche ou en enseignement, doivent profiter à la société.
Q. L. : quelle est votre capacité d’action en tant que doyen pour faire face à un enjeu de société, par exemple, celui de l’exode des médecins vers le privé ?
P. C. : je ne suis pas responsable de l’organisation des soins, mais je peux avoir une opinion sur leur organisation et sur la façon dont ils sont dispensés. Je siège notamment dans des conseils d’administration, comme ceux du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. J’y occupe surtout le rôle de représentant de la recherche et l’enseignement. Je contribue donc à leur fonctionnement, directement ou indirectement.
Q. L. : comment avez-vous fait pour vous forger une opinion sur l’exode des médecins du réseau public de la santé et, de manière plus générale, sur le projet de loi 83 ?
P. C. : la Faculté de médecine rencontre régulièrement les deux ministères concernés, soit le ministère de l’Enseignement supérieur et celui de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de différentes réunions. Plusieurs forums existent notamment pour le permettre, comme la Conférence des doyens des facultés de médecine du Québec (CDFM), qui se réunit une fois par mois.
De plus, des représentants des ministères viennent nous rencontrer régulièrement et nous ont donné l’occasion de nous exprimer avant l’annonce publique du projet de loi.
Q. L. : comment faites-vous pour prendre le pouls de la communauté étudiante, notamment en ce qui concerne le projet de loi 83 ?
P. C. : par des discussions, formelles et informelles, avec les étudiants. Je rencontre aussi régulièrement les associations étudiantes et, parfois, la Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ). Si je n’ai pas reçu d’étudiants personnellement, la vice-doyenne aux études médicales de premier cycle, Geneviève Grégoire, est en contact constant avec les étudiants. Elle les voit presque chaque jour.
Q. L. : contrairement à la FMEQ, la CDFM ne recommande pas l’abandon du projet de loi 83 dans son mémoire destiné à la Commission parlementaire sur la santé et des services sociaux de l’Assemblée nationale du Québec. Pourquoi ce choix ?P. C. : comme les facultés de médecine enseignent exclusivement dans le système public, nos étudiants ne sont pas exposés à la pratique privée. Nous sommes d’accord avec le ministre de la Santé lorsqu’il affirme qu’un système de santé doit être universel et accessible, nous sommes réellement préoccupés par la croissance du secteur privé de la santé au Québec. Nous comprenons ses préoccupations et c’est sa prérogative d’intervenir. Bien que nous comprenions que les mesures proposées par le projet de loi soient contraignantes pour les étudiants, nous ne pouvons pas nous y opposer. Nous avons toutefois émis certaines réserves sur les moyens mis en œuvre. Nous avons clairement indiqué dans notre mémoire que d’autres mesures qui concernent l’ensemble des médecins, et pas uniquement les nouveaux diplômés, pourraient être privilégiées.
Crédit photo : Nicolas Bougeard