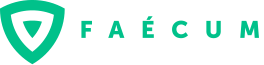Le dernier long-métrage du cinéaste Walter Salles, Je suis toujours là, est dans les salles québécoises depuis le 31 janvier dernier. Ce drame biographique est une adaptation du livre éponyme de Marcelo Rubens Paiva, qui revient sur la disparition de son père pendant la dictature militaire brésilienne. Sans tomber dans la surdramatisation, l’œuvre réussit ainsi à faire côtoyer la fiction et la réalité.
Le récit s’ouvre sur le portrait lumineux de la famille Paiva. Dans leur grande maison de Rio de Janeiro, les parents reçoivent régulièrement leurs ami·e·s pour manger du soufflé ou danser au son des vinyles, tandis que la plage de Leblon accueille leurs baignades et leurs parties de volley-ball. En partageant des instants de leur vie, les spectateur·rice·s s’attachent aussitôt à Eunice, à Rubens et à leurs cinq enfants attendrissants.
Pourtant, dès les premiers plans, l’armée brésilienne alourdit l’ambiance par sa présence sonore, entre les grondements d’hélicoptères et les tanks qui sillonnent la côte. La dictature militaire qui a ébranlé le pays de 1964 à 1985 sert d’abord de toile de fond, avant de s’immiscer dans le quotidien des protagonistes. Walter Salles déconstruit ainsi les apparences idylliques, créant une inquiétude prémonitoire de la suite des événements.
La mise en scène illustre brillamment le contrôle de l’armée sur les êtres et les espaces, en infusant un sentiment de claustrophobie à la fois chez les personnages et chez le public. Lors de l’arrestation de Rubens, par exemple, des hommes de main imposent leur présence dans la maison : Eunice et ses enfants sont contraints de se cloîtrer entre quatre murs, les rideaux de la demeure tirés et les portes verrouillées. Leur refuge, désormais soumis au pouvoir absolu, donne une sensation d’étouffement à travers l’écran.
Ce huis clos atteint son paroxysme lors de l’emprisonnement d’Eunice, où les mêmes gestes se répètent. Pendant douze jours, des soldats escortent le personnage de sa cellule étroite aux lumières crues de la salle d’interrogatoire; seuls des traits de craie contre le mur raccrochent l’audience à la notion du temps. La tension du film ne réside pas dans un simple suspense narratif, mais sur l’incertitude totale des Paiva quant à leur destin et celui de leurs proches.
Le réalisateur choisit de montrer la lutte d’Eunice pour obtenir la vérité sur son mari, au cours d’une intrigue qui s’étend sur plus de quarante ans. Par l’entremise de cette fresque intime, Je suis toujours là met en lumière un souvenir douloureux mais important de l’Histoire brésilienne : celui des nombreuses personnes tué·e·s et disparu·e·s pendant la dictature, et les conséquences psychologiques qui en résultent.
Tourner le long-métrage en 35 mm témoigne avec pertinence du caractère précieux des souvenirs. À la diégèse se mêlent des extraits en pellicule 8 mm, filmés par les personnages. Les images au grain épais et constellées de lumières vives capturent avec justesse le souvenir des moments insaisissables. Chaque document matériel attestant de l’histoire des Paiva devient alors une preuve inestimable, face à une armée qui cherche à effacer les traces de ses crimes.
Walter Salles ouvre une réflexion, toujours aussi actuelle, sur l’importance de la mémoire. Dans l’épilogue, qui se déroule en 2014, Eunice, alors atteinte de la maladie d’Alzheimer, est bouleversée lorsqu’elle revoit le visage de Rubens dans un reportage sur la dictature. Un choc partagé par le public, qui, après avoir suivi son parcours de vie jusqu’au deuil de son mari, ressent lui aussi une profonde nostalgie.
L’appel au boycottage du film Je suis toujours là par l’extrême droite brésilienne prouve la nécessité de raviver le passé, aussi violent soit-il. Dans un contexte de tensions géopolitiques et de montée d’idéologies oppressives, le film trouve une certaine résonance. Au-delà d’adapter des faits réels en long-métrage, le réalisateur rappelle que l’Histoire n’est jamais révolue et qu’elle se répétera si la population autorise son oubli.
Où voir Je suis toujours là ? En version originale sous-titrée en français au Cinéma Beaubien et au Cineplex Odeon Quartier latin, et sous-titrée en anglais au Cinéma du Parc et au Cineplex Forum.