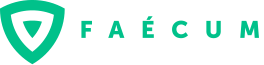Les chiffres, tirés du dernier rapport de l’Association québécoise interuniversitaire des conseillers aux étudiants en situation de handicap (AQICESH), ne surprennent pas la coordonnatrice du Service de soutien à l’apprentissage à la réussite de l’UdeM, Dania Ramirez. En entrevue à Radio-Canada, elle avance que cette augmentation s’explique, entre autres, par un meilleur dépistage du TDAH au primaire ou au secondaire, qui permet à plusieurs étudiants aux prises avec ce trouble de poursuivre leurs études. « On leur a offert des services, on les a soutenus pour qu’ils puissent accéder aux études supérieures », soulève-t-elle.
Ces services se retrouvent également à l’université. Par exemple, à l’UQAM, il est possible qu’une personne rémunérée prenne des notes pour un étudiant souffrant d’un TDAH. Des salles d’examens isolées sont également disponibles, pour les étudiants qui disposent d’une attestation d’un professionnel de la santé confirmant le diagnostic.
À l’UdeM, le Service de soutien à l’apprentissage s’est élargi au cours des dix dernières années, selon Mme Ramirez. « J’étais pratiquement seule au service, et maintenant nous avons quatre psychologues, trois orthopédagogues et deux neuropsychologues », raconte-t-elle.
Sensibiliser au TDAH
Le titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand de l’UQAM, Frédérick Gagnon, a confié à Radio-Canada avoir remarqué des situations délicates en classes. « Il y a des étudiants que se demandent, par exemple, pourquoi il y a une personne qui a plus de temps pour faire un examen, pourquoi une personne a une semaine de plus pour réaliser un travail de session », illustre-t-il.
Les professeurs aussi peuvent avoir des réticences, selon Mme Ramirez. « Pour le professeur, c’est de s’assurer que s’il met en place un accommodement pour un étudiant, c’est justifié et que derrière, il y a un diagnostic rigoureux qui est fait », dit la psychologue.
Les universités sont tenues d’accommoder les étudiants en situation de handicap en vertu de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne : « Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur […] le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. »