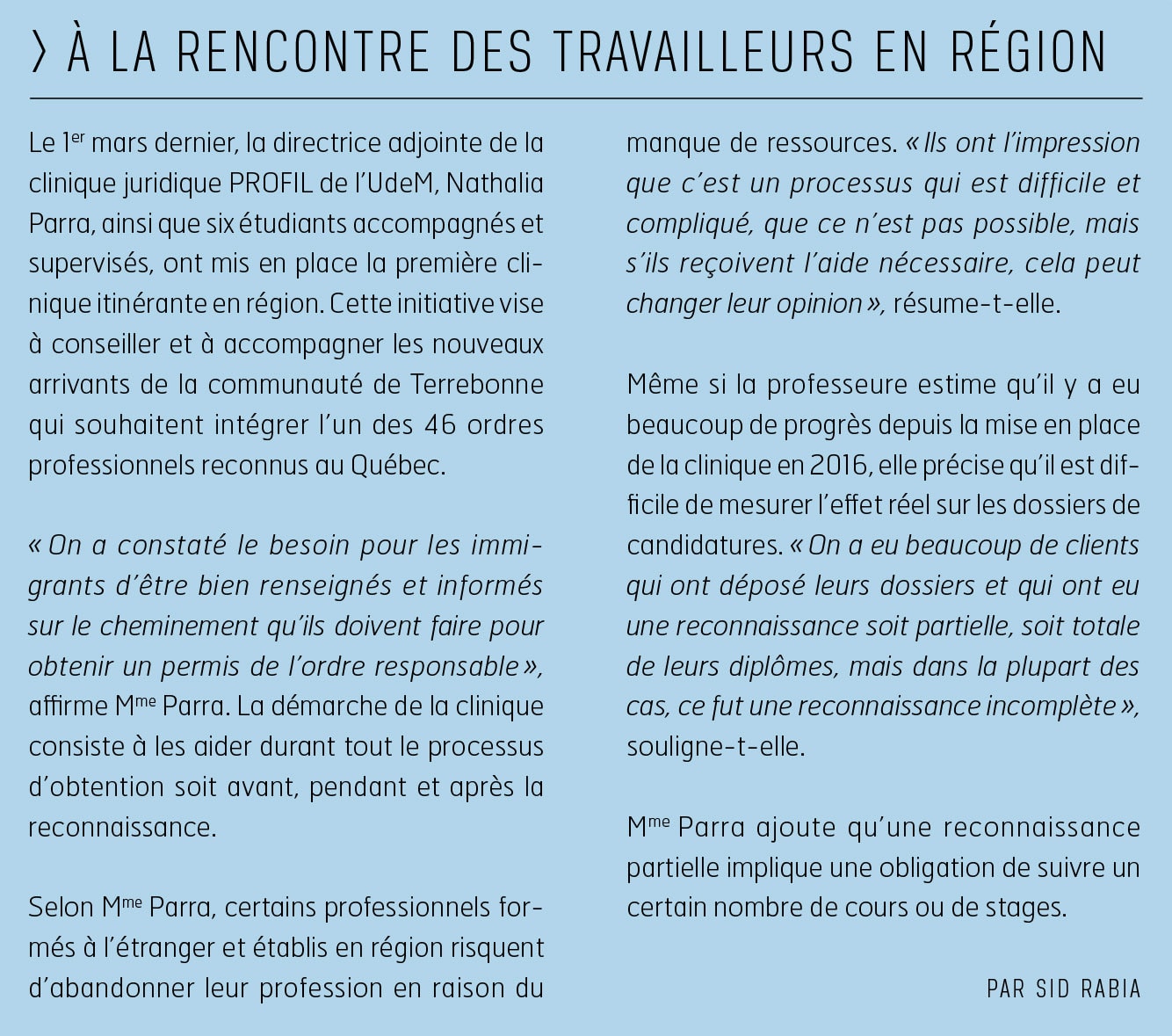«Pour moi, c’est une question démocratique», affirme M. Noreau, qui déplore que le système de justice actuel transpose en droit les inégalités sociales, notamment en raison des coûts de défense et de la complexité des textes. Pour lui, c’est à la société d’en assurer l’accessibilité.
« Plus on est nombreux, plus on est susceptible d’avoir des problèmes avec d’autres personnes, dit-il. Les risques qu’on s’entrechoque en voiture ne sont pas nuls et il semble normal que la société prévoie des solutions, puisque c’est la vie en société qui cause ces risques. »
Selon le site Internet du projet de recherche, l’ADAJ « pose le problème des relations difficiles entre le citoyen et le monde juridique, au sein des sociétés complexes ». Le sondage Justice pour tous, effectué dans le cadre du projet, indique que 58 % des Québécois disent faire confiance au système de justice alors que 42 % des participants à l’enquête entretiennent une opinion plus nuancée, voire négative, à l’égard du système judiciaire (1).
Comprendre la loi
La directrice générale de l’organisme partenaire Éducaloi, Ariane Charbonneau, abonde dans le même sens. « L’accès au droit et à la justice, c’est bien plus large que l’accès aux tribunaux ; c’est l’accès à l’information et le développement des aptitudes juridiques pour anticiper une situation juridique », souligne-t-elle. Mme Charbonneau précise qu’il ne s’agit pas de délivrer des conseils juridiques à des particuliers sur leur situation, mais de les informer sur l’état du droit. « Ça permet aux gens de comprendre la complexité de leur situation, explique-t-elle. Nous, on ne sort pas tous nos pancartes dans la rue pour dire qu’une loi est bonne ou non, mais on milite pour améliorer l’accès à l’information. »
M. Noreau insiste sur le fait qu’il ne faut pas faire du droit la solution miracle. « L’accès au droit doit précéder l’accès à la justice, précise-t-il. Il faut commencer par diminuer la complexité des textes, puis rendre l’accès à la cour plus facile, et, par exemple, rendre la médiation et l’arbitrage plus accessibles. »
« Cela faisait longtemps qu’il n’y avait pas eu un vent de réforme en droit criminel, affirme la professeure agrégée à l’École de criminologie de l’UdeM Chloé Leclerc. Tout le monde a envie que ça bouge. » Elle souligne que le taux de renonciation est l’un des indicateurs efficaces pour évaluer les difficultés de l’accès au droit. « Il est important de se demander pourquoi la moitié des personnes incarcérées renoncent à leurs droits, notamment à celui de demander une libération conditionnelle, souligne celle qui est également chercheure pour trois chantiers de l’ADAJ. On peut avancer plusieurs facteurs, comme la vulnérabilité sociale et le contact limité avec l’extérieur. Ce qui est marquant, c’est que ce problème touche plus fortement les Autochtones. »
De la recherche à l’action ?
L’ADAJ comporte un volet d’étude empirique des réalités entourant l’accès au droit et à la justice, mais aussi le développement de pratiques novatrices dans le cadre de quinze projets pilotes élaborés et menés de concert avec les partenaires. « Le ministère de la Justice est engagé dans plusieurs de nos projets et est intéressé par plusieurs de nos conclusions, en vue d’entreprendre des politiques publiques », indique M. Noreau. « Changer les choses dans la pratique, ça prend une recherche fondamentale », affirme la professeure à la Faculté de droit de l’UdeM et cochercheuse de l’ADAJ Johanne Clouet.
Actuellement au stade de la récolte de données, sa recherche porte sur les coûts humains du passage par une procédure judiciaire. « L’accès au droit et celui à la justice sont deux questions distinctes, mais l’une ne va pas sans l’autre ; avoir des droits, c’est bien, mais encore faut-il pouvoir les défendre », indique la chercheure, dont l’objectif est d’évaluer, au-delà des coûts financiers, les coûts humains de la procédure judiciaire.
« On parle directement au justiciable pour connaître son expérience, ce que lui a coûté son passage par le système de justice, mais aussi l’impact sur son entourage », raconte Mme Clouet. M. Noreau explique que son équipe est en train de développer un service d’accompagnement au palais de justice de Montréal, afin de ne pas laisser les gens seuls face à la justice. « C’est la solution immédiate, mais à long terme, il faut repenser l’accompagnement, précise-t-il. Selon notre sondage, 90 % des gens préfèreraient être accompagnés par un avocat et 75 % des personnes croient ne pas avoir les moyens de se payer un avocat. »
Penser le droit au futur
L’édition 2019 de l’université d’été ADAJ, qui se déroulera du 17 au 21 juin prochains, s’inscrit dans le mandat éducatif du programme, qui inclut la formation de 150 étudiants de diverses disciplines. La doctorante à la Faculté de droit Shana Chaffai Parent représente tous les étudiants du projet au comité scientifique, qui coordonne l’ensemble du projet et se réunit une fois par mois. « Je me suis greffée au projet quand le conseil a été créé, raconte-t-elle. Ils cherchaient des représentants étudiants et j’ai manifesté mon intérêt. On est tous conscients des problèmes d’accès à la justice. Moi, j’ai quitté mon emploi dans un cabinet pour trouver des solutions à ces problèmes. C’est ma manière de faire du militantisme. »
Pour Shana, la multiplicité des acteurs et leurs intérêts divergents rendent la situation compliquée. « C’est un milieu fortement institutionnalisé, où beaucoup d’acteurs ont des intérêts différents et la chimie n’est pas toujours simple, souligne la doctorante. On peut commencer par des solutions à petite échelle, puis calculer leurs impacts et donner l’exemple pour les implanter ailleurs. »
« Ce n’est pas du tout insurmontable. Il y a plein de choses à faire ! », affirme avec optimisme M. Noreau. Interrogé sur sa vision pour l’avenir du projet, le professeur confie qu’il pense déjà à un « ADAJ 2 », qui se déroulerait sur une période plus longue et sur une base internationale.